 L’un s’est retiré dans le Sud-Ouest de la France pour cultiver son jardin, activité à laquelle il n’avait jamais cessé d’accorder la plus grande importance, et poursuivre l’écriture de notes de lecture, d’impressions diverses, de poèmes, de textes de fiction, dans lesquels se reflète, avec une rare acuité, sa vision du monde et de la littérature ; l’autre poursuit les réflexions entreprises dans Aimer, enseigner, son précédent essai, et se pose en défenseur d’une école libérée de tout dogme utilitariste et de l’autonomie des enseignants. Complices en pensée, comme longtemps ils l’ont été dans l’animation de la revue Liberté, Jean-Pierre Issenhuth et Yvon Rivard ont fait paraître, le premier à titre posthume, deux essais dans lesquels on retrouvera la manière propre à chacun d’appréhender le monde et d’opposer aux idéologies qui ont aujourd’hui cours un esprit résolument critique et libre.
L’un s’est retiré dans le Sud-Ouest de la France pour cultiver son jardin, activité à laquelle il n’avait jamais cessé d’accorder la plus grande importance, et poursuivre l’écriture de notes de lecture, d’impressions diverses, de poèmes, de textes de fiction, dans lesquels se reflète, avec une rare acuité, sa vision du monde et de la littérature ; l’autre poursuit les réflexions entreprises dans Aimer, enseigner, son précédent essai, et se pose en défenseur d’une école libérée de tout dogme utilitariste et de l’autonomie des enseignants. Complices en pensée, comme longtemps ils l’ont été dans l’animation de la revue Liberté, Jean-Pierre Issenhuth et Yvon Rivard ont fait paraître, le premier à titre posthume, deux essais dans lesquels on retrouvera la manière propre à chacun d’appréhender le monde et d’opposer aux idéologies qui ont aujourd’hui cours un esprit résolument critique et libre.
Essayiste curieux de tout, comme le souligne François Hébert dans sa présentation (tout aussi personnelle qu’éclairante), Jean-Pierre Issenhuth n’aura eu de cesse d’observer, d’interroger, de commenter la vie sous toutes ses formes, tant celle de l’esprit que celle des organismes vivants, comme les lombrics, auxquels nous ne prêtons habituellement aucune attention. Les textes rassemblés dans Le jardin parle1, par son épouse avec la complicité d’Yvon Rivard, témoignent de cette insatiable curiosité qui l’amenait à s’intéresser à la création sous ses multiples formes, littéraires comme scientifiques. « L’écriture était pour lui une fidélité ouverte sur les mystères de la vie », écrit François Hébert, et ces mystères trouvaient autant à solliciter son attention, sa bienveillance dans la poésie ou la science, révélant en cela une volonté d’appréhender le monde en humaniste plutôt qu’en spécialiste. Tout au long de sa carrière de conseiller pédagogique à la Commission des écoles catholiques de Montréal, cette volonté d’échapper à une vision technocratique, voire utilitariste de l’enseignement, sous couvert d’approches pédagogiques douteuses, ne cessera de l’animer, parfois avec une ironie mordante pour mieux dénoncer les dérives d’obscures réformes, dont le nouveau programme optionnel de français pour les quatrième et cinquième années du secondaire, au moment où Claude Ryan était ministre : « L’introduction du programme, à elle seule, constitue un plat de résistance langagier. On sent tout de suite que le fonctionnaire anonyme qui a pondu cette chose est féru de vécu, de milieu, de socioculturel et de communication. C’est peut-être un agent du milieu recyclé ? Un psychologue reconverti ? Un travailleur social au repos ? Un professeur de formation personnelle et sociale à la retraite ? On se perd en conjectures ». Le ton, comme l’esprit qui l’anime, est donné. L’ironie agit ici à titre de garde-fou contre la bêtise.
Cette absence de complaisance, qu’il applique à sa propre personne avec un humour non moins senti que lorsqu’il manie l’ironie, on la retrouvera dans ses notes de lecture d’ouvrages littéraires, ceux de science trouvant plus souvent grâce à ses yeux, sans doute en ce qu’ils ne cherchent pas tant à l’éblouir qu’à le renseigner sur l’état du monde. Écologiste, Issenhuth l’était avant tout par la somme des gestes qui composaient ses journées. D’entrée de jeu, dans le texte qui s’intitule « De la vie spirituelle considérée dans ses rapports avec l’Orient », Issenhuth annonce ses couleurs en reprenant en quelque sorte la règle de vie énoncée par Voltaire, selon laquelle il est préférable de savoir sarcler correctement son jardin que de multiplier les diplômes universitaires qui ne permettent pas toujours de déposer des haricots dans les assiettes. En Thoreau, il reconnaîtra un frère d’armes : « Des haricots, Henry David Thoreau n’avait pas besoin d’en demander, au pape ni à personne. Il en sarclait tout un carré, près de sa cabane et de l’étang. Allant et venant, il sarclait aussi les pensées de son esprit et les émotions de son âme. De temps à autre, il rentrait se replonger dans quelque livre hindou. Où en était sa croissance spirituelle ? Je l’ignore, mais je suis porté à le considérer comme un maître égal à Eckhart, et qui peut mener aussi loin que lui, par le moyen du sarclage ». On ne s’étonnera donc pas, le moment venu de ranger ses outils, que les almanachs aient souvent eu préséance sur de nombreux ouvrages littéraires.
Le jardin parle, c’est aussi l’occasion de quelques coups de chapeau bien sentis aux auteurs que Jean-Pierre Issenhuth estimait, lui qui avouait du même souffle que la plupart des livres contemporains lui tombaient des mains. Il avait trouvé en Flannery O’Connor une âme sœur, une façon d’être, lucide et sans compromis, libre de pose, de chichis de bas bleu comme de faux-col amidonné. Et sans doute un humour et un esprit de dérision communs. L’attention qu’accordait Flannery O’Connor à ses paons et à ses canards trouvait en lui un écho certain.
Nadia Boulanger, Rina Lasnier, Peter Handke, Julien Gracq, Dino Buzzati, Marcel Proust, Yves Bonnefoy, René Char, certains auteurs russes, dont Mikhaïl Boulgakov, et québécois, dont Pierre Vadeboncœur, et d’autres encore, méconnus, voire oubliés (Jean-Paul de Dadelsen), figurent également au nombre des auteurs à qui il était redevable d’avoir tracé des sillons qui méritaient l’admiration.
Quelques poèmes, des textes en prose à la frontière de la nouvelle et du conte sont parsemés ici et là parmi les réflexions, autres notes et commentaires critiques, lettres qui composent l’ensemble. L’écriture, classique, y est précise et limpide. La phrase de Issenhuth se déploie avec la même hardiesse que les gestes du jardinier, révélant la même précision dans les termes, le même respect de l’outil.
On ne peut évidemment épuiser la richesse de présence et de réflexion contenue dans ces pages, les appels à cultiver son propre jardin loin du tumulte quotidien qui distrait de l’essentiel. Il nous faut sans doute garder l’image d’un érudit doublé d’un élève d’une insatiable curiosité, ce qu’il exprimait en ces termes : « En construisant, avec des matériaux de rebut, une cabane où je me tiendrais aussi souvent que m’y autoriseraient les nécessités quotidiennes, j’ai voulu tenir à distance, dans la mesure du possible, la religion du confort, le culte des aises et de l’apparence, choses qui, dans l’époque, me déplaisaient le plus. […] À la recherche d’un nouveau degré d’éloignement du train du monde, je me suis enfoncé dans le sol arable pour l’étudier ». Et, ajouterons-nous, pour nous partager ses observations.
L’autre chemin
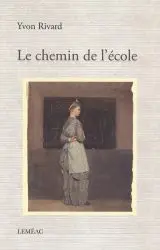 Aimer, enseigner, le précédent essai d’Yvon Rivard, venait en quelque sorte ponctuer 35 années d’enseignement de la littérature à l’Université McGill, ouvrage qui l’avait amené à s’interroger et à réfléchir sur son parcours, sur le sens que revêt aujourd’hui l’enseignement, plus particulièrement de la littérature, et sur celui d’accepter la responsabilité d’accompagner les étudiants dans leur propre cheminement. Le chapitre n’était pas clos pour autant (l’est-il jamais lorsqu’on a consacré sa vie professionnelle à une activité qui nous passionne ?). Dans Le chemin de l’école2, Yvon Rivard poursuit la réflexion entreprise, et l’échange qu’il souhaite établir avec ses lecteurs, élèves d’hier aujourd’hui devenus enseignants, comme avec tous ceux et celles qui portent un intérêt véritable à l’enseignement, en insistant sur la notion de cheminement plutôt que d’acquisition, comme l’indique le titre, dans la perspective de développer chez l’élève une véritable autonomie, prémices essentielles à l’atteinte de la liberté. Dans une société qui a tendance à vouloir tout juger à l’aune de la comptabilité, Rivard nous rappelle, ce qui s’avérera la trame de fond de son essai, le mot célèbre d’Albert Einstein : « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément ».
Aimer, enseigner, le précédent essai d’Yvon Rivard, venait en quelque sorte ponctuer 35 années d’enseignement de la littérature à l’Université McGill, ouvrage qui l’avait amené à s’interroger et à réfléchir sur son parcours, sur le sens que revêt aujourd’hui l’enseignement, plus particulièrement de la littérature, et sur celui d’accepter la responsabilité d’accompagner les étudiants dans leur propre cheminement. Le chapitre n’était pas clos pour autant (l’est-il jamais lorsqu’on a consacré sa vie professionnelle à une activité qui nous passionne ?). Dans Le chemin de l’école2, Yvon Rivard poursuit la réflexion entreprise, et l’échange qu’il souhaite établir avec ses lecteurs, élèves d’hier aujourd’hui devenus enseignants, comme avec tous ceux et celles qui portent un intérêt véritable à l’enseignement, en insistant sur la notion de cheminement plutôt que d’acquisition, comme l’indique le titre, dans la perspective de développer chez l’élève une véritable autonomie, prémices essentielles à l’atteinte de la liberté. Dans une société qui a tendance à vouloir tout juger à l’aune de la comptabilité, Rivard nous rappelle, ce qui s’avérera la trame de fond de son essai, le mot célèbre d’Albert Einstein : « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément ».
Après avoir évoqué son propre parcours d’élève, d’une école de rang en Mauricie jusqu’à la Sorbonne, en soulignant avoir eu la chance de ne pas avoir été formé par des pédagogues, Yvon Rivard énonce ce qui aura, tout au long de sa carrière, guidé sa propre démarche d’enseignant. Avant de s’en remettre à quelque docte et savante théorie pédagogique, il faut savoir être réceptif, accueillir une œuvre et accepter d’être transformé par elle. L’émotion l’emporte ici sur la connaissance théorique. « Ma méthode était simple, écrit Rivard, voire simpliste : je ramenais tout à ce moi qu’avaient éveillé, ébranlé, divisé tel livre, telle phrase, telle pensée. » Une telle méthode, on le comprend aisément, est à l’opposé de celle enseignée dans les tours où l’on forme les futurs enseignants, où l’on cherche davantage à les outiller qu’à leur inculquer l’amour du métier, l’importance d’une présence. Ce qui l’amène à revenir sur la réforme survenue en 1993 dans le réseau collégial, au moment où l’on a supprimé un cours de philosophie et cherché à orienter les cours de littérature afin qu’ils soient plus adaptés à la formation de l’étudiant, en dénonçant l’objectif d’utilitarisme sous-jacent, à ses yeux, de cette réforme. En ce qui concerne la gratuité scolaire, Rivard rappelle qu’elle ne doit pas être que monétaire, revendiquant ici « qu’il ne fallait pas tant rendre l’université accessible à tous que préserver le plus grand nombre de la formation de ‘comptables’ qu’elle donne ».
Appeler chaque élève par son nom, comme s’évertuait à le faire Jean-Pierre Issenhuth, c’est en quelque sorte l’a priori de la gratuité scolaire, le premier pas dans l’accompagnement de l’élève sur le chemin de l’école, souligne Yvon Rivard pour qui l’être doit avoir préséance sur l’avoir dans la relation qui s’établit entre l’enseignant et l’élève. « Aimer et enseigner, écrit-il, c’est conférer à l’enfant, à l’élève une valeur d’être, lui apprendre à aimer et connaître ce qu’il est, quelles que soient ses forces et ses faiblesses, jusqu’à ce qu’il en vienne à aimer et connaître l’être dont il fait partie, le grand dehors dans lequel il va se reconnaître et se perdre. » L’objectif ultime d’une véritable éducation devrait permettre d’assurer l’harmonie sociale, le respect des uns et des autres sans considération des choix individuels.
Dans le chapitre intitulé « Devoir de secourir, devoir d’éveiller », Yvon Rivard lance ni plus ni moins qu’un cri du cœur en vue de préserver la formation générale contre « la bêtise savante et marchande » qui a conduit à privilégier la spécialisation précoce et stérile au détriment de l’éveil et du goût de la connaissance de soi et du monde. Le rôle de la littérature, si tant est qu’elle ait un rôle à jouer, n’est pas utilitaire. Plus que permettre à l’élève de développer des compétences, d’écrire tant de mots au terme de tel cours avant d’accéder au suivant, dont on aura majoré la difficulté comptable, elle doit lui donner l’occasion « de découvrir qu’existe en lui un espace dans lequel il peut se réfugier pour échapper à la violence du monde, mais qui peut aussi contenir toute la beauté et l’étrangeté du monde ». Avant de rechercher l’acquisition, le cumul de connaissances, la relation pédagogique doit d’abord s’établir sur le terrain affectif, sur la confiance et le respect. On ne sera pas surpris que Rivard invite les enseignants à la désobéissance en vue d’échapper à l’uniformisation recherchée pour chacun des cours dont il arrive même que le mot littérature ait été retranché. On ne sera pas non plus surpris qu’il pose un regard critique sur le recours aux grilles d’analyse pour disséquer une œuvre plutôt que de permettre à l’étudiant de se laisser pénétrer par cette dernière, de se laisser porter par sa tension jusqu’à en être ébranlé parfois.
Dans un autre chapitre, Yvon Rivard revient sur ce qu’il qualifie, dans sa pratique d’enseignant, de petite grammaire de création littéraire qui repose avant tout – et avant tout truc de métier, pourrait-on préciser – sur une exigence éthique, ce qui lui donne ici l’occasion de dénoncer une fois de plus l’abus de pouvoir de certains enseignants mis en présence d’élèves vulnérables en quête d’eux-mêmes. Une fois de plus, la notion d’accompagnement, de cheminement est ici au cœur de la pratique de Rivard, qui s’appuie sur ses auteurs de prédilection, dont Kafka : « Quand il est juste, le mot conduit ; quand il ne l’est pas, il écarte du chemin ». Au cœur de cette pratique, Yvon Rivard insiste sur l’importance du choc premier, de la tension interne à toute œuvre (entre le moi et le non-moi, précise-t-il, entre ce que l’on voit et ce que l’on imagine, entre le rêve et la réalité, Rivard faisant ici référence à Julio Cortázar à ce sujet), tension qu’il faut savoir découvrir avant de songer à embellir le propos, les phrases, voire les images qui, parfois, peuvent occulter l’essentiel du propos. Oublier le style, chercher la forme. Telle est la voie qu’il indique à ses étudiants. « Chercher la forme, c’est […] accepter que les choses résistent aux mots et que les mots résistent aux choses, jusqu’à ce qu’une forme naisse de cette discorde ». Ce n’est qu’une fois atteinte, pourrait-on conclure, que l’harmonie tant recherchée se révélera.
Le chemin de l’école est parsemé de réflexions et de notations qui animeront sûrement les discussions au sein de nombreux départements de littérature, du moins peut-on l’espérer, car ce qui ici est en jeu, au-delà même de l’enseignement de la littérature ou de toute autre matière, au-delà de toute approche pédagogique censée outiller les enseignants, c’est la liberté accordée aux élèves de pouvoir cheminer en toute confiance et en toute liberté vers la découverte de soi et du monde, et d’y être accompagné par qui se souvient d’avoir un jour ressenti l’excitation et la crainte devant l’inconnu.
1. Jean-Pierre Issenhuth, Le jardin parle, Nota bene, Montréal, 2019, 269 p. ; 26,95 $.
2. Yvon Rivard, Le chemin de l’école, Leméac, Montréal, 2019, 125 p. ; 15,95 $.
EXTRAITS
The Old Farmer’s Almanac va entamer sa 193e année. Quel exemple de stabilité ! Voilà ce qui arrive quand on ne traite que de sujets éternels comme les conjonctions d’astres, les tremblements de terre, la valeur nutritive des fumiers, les distractions pour les jours de pluie (par ailleurs annoncés), le calendrier des marées, les rapports entre le jus de concombre et la beauté…
Jean-Pierre Issenhuth, Le jardin parle, p. 16.
Vieux madriers, vieilles planches, vieux clous, vieilles fenêtres de bois condamnées à pourrir, tout ce qu’on jette, tout ce qu’on refuse, tout ce à quoi on n’attache aucune valeur m’a toujours intéressé. La perte de confiance à l’égard de ce que l’époque juge beau, utile et important, n’est certainement pas étrangère à cet intérêt.
Jean-Pierre Issenhuth, Le jardin parle, p. 97.
Au fil des années, je n’ai pas cessé d’être exposé au discours pédagogique, et il m’a paru fortement marqué par la redécouverte périodique de la roue. Évidemment, quand elle redécouvre la roue, la théorie pédagogique ne l’appelle pas « roue ». Elle l’appelle, mettons, « disque locomoteur » et, pendant quelque temps, on se laisse abuser par le mirage de la nouveauté verbale…
Jean-Pierre Issenhuth, Le jardin parle, p. 221.
L’école devrait être une fortification du rêve, du jeu et de la pensée, un lieu fermé qui ne s’ouvre sur le monde que par ses fenêtres.
Yvon Rivard, Le chemin de l’école, p. 14.
Vivre humblement en accord avec une pensée aspirée par le désir d’harmonie pourrait bien être la meilleure définition de la culture.
Yvon Rivard, Le chemin de l’école, p. 24.
Chercher et trouver la forme, c’est être fidèle à ce mouvement qui nous fait passer d’une chose à l’autre, de la réalité au rêve, du rêve à la réalité, d’une façon d’exister à une autre.
Yvon Rivard, Le chemin de l’école, p. 90.










