Pourquoi un livre paraît-il dix ans après la mort de son auteur, peut-on se demander à propos de Les Cuivas de Bernard Arcand (apprécions-en le sous-titre : Une ethnographie où il sera question de hamacs et de gentillesse, de Namoun, Colombe et Pic, de manguiers, de capybaras et de yopo, d’eau sèche et de pêche à l’arc, de meurtres et de pétrole, de l’égalité entre les hommes et les femmes1) ? Après tout, il ne repose pas sur une recherche récente, mais sur celle menée il y a cinquante ans, aux fins d’un doctorat, sur un peuple de la savane colombienne.
À cette question répond la toute première phrase de la préface de Christine et Stephen Hugh-Jones, deux anthropologues formés à Oxford, comme Arcand, par le grand Edmund Leach : « Les Cuivas est le livre que Bernard Arcand a toujours eu l’intention d’écrire, mais qu’il n’a jamais réussi à terminer » en dépit du travail qu’il y a mis. Or, c’est le seul manuscrit dont il n’a pas, à l’approche de la mort, demandé qu’on le jette. Sachons gré à Sylvie Vincent, Serge Bouchard et Ulla Hoff, sa compagne de toujours (qui signe un émouvant avant-propos), d’avoir complété à notre profit le travail d’un… ancien jeune chercheur.
À la lecture du chapitre intitulé « L’après-terrain ou comment apprendre à se taire », on est tenté de proposer une autre réponse à l’interrogation initiale : ne s’agirait-il pas en fait du livre que très longtemps il n’a pas voulu écrire par peur de compromettre ceux auprès de qui il avait autrefois vécu ? Je sais qu’en posant le problème sous cet angle, en jouant de l’inversion, je fais comme aurait pu agir Bernard Arcand, jongleur amusé – ça lui apprendra !
Oui, Bernard Arcand, le fils de Deschambault, le professeur estimé, le partenaire de Bouchard dans ce qui a fait école à la radio et en édition, Les lieux communs, l’auteur de l’enjoué Abolissons l’hiver ! et de Le jaguar et le tamanoir, anthropologie de la pornographie (prix du Gouverneur général en 1991), le citoyen engagé dans la vie culturelle et intellectuelle de Québec. Soyez prévenus : sous le compte rendu d’un ouvrage passionnant se trouve un hommage à quelqu’un d’estimable.
Savane et champ droit
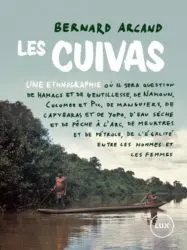 Parlons donc de l’homme. Il a été un jeune anthropologue, à l’époque où l’anthropologie, pourtant centenaire, était encore jeune dans la mesure où la terra incognita persistait ici et là. Lire aujourd’hui Les Cuivas, c’est plonger dans une époque où, aux yeux de Pierre Falardeau, son cadet de deux ans (1946-2009), être anthropologue, c’était « faire du canot sur l’Amazone », jusqu’à ce qu’il comprenne à l’université qu’il fallait aussi « lire des gros livres ». Arcand et Falardeau dans le même canot, ça peut étonner, on les envisage plutôt aux antipodes l’un de l’autre, à moins de considérer leur commune maîtrise de la langue, imagée, excessive, explosive chez l’un, mesurée, réfléchie et… imagée chez l’autre. Comme dispensateur d’images, Bernard Arcand aussi ne donnait pas sa place. Il savait tourner une expression avec la patience du potier, Les lieux communs le prouvent d’abondance. Chez lui, l’art de la conversation prenait des allures de tennis, la repartie pouvait surprendre et fragiliser les évidences sur lesquelles on fonde si souvent ses opinions. Sous couvert d’abolir l’hiver, il a rappelé les mérites de la saison qu’on met tant d’efforts à dénaturer et à détester. Je l’entends aussi relater une soirée de baseball à San Francisco, ramenée pour le coup à la personne du joueur de champ droit Barry Bonds, aux genoux de Barry Bonds, à l’économie (étymologiquement : « administration de la maison ») des genoux de Barry Bonds. Artefacts, sport, stade, foule entonnant Take Me out to the Ball Game, tout était chez lui prétexte à interprétation. Lire Les Cuivas, c’est en somme aller à l’origine d’une féconde attitude intellectuelle.
Parlons donc de l’homme. Il a été un jeune anthropologue, à l’époque où l’anthropologie, pourtant centenaire, était encore jeune dans la mesure où la terra incognita persistait ici et là. Lire aujourd’hui Les Cuivas, c’est plonger dans une époque où, aux yeux de Pierre Falardeau, son cadet de deux ans (1946-2009), être anthropologue, c’était « faire du canot sur l’Amazone », jusqu’à ce qu’il comprenne à l’université qu’il fallait aussi « lire des gros livres ». Arcand et Falardeau dans le même canot, ça peut étonner, on les envisage plutôt aux antipodes l’un de l’autre, à moins de considérer leur commune maîtrise de la langue, imagée, excessive, explosive chez l’un, mesurée, réfléchie et… imagée chez l’autre. Comme dispensateur d’images, Bernard Arcand aussi ne donnait pas sa place. Il savait tourner une expression avec la patience du potier, Les lieux communs le prouvent d’abondance. Chez lui, l’art de la conversation prenait des allures de tennis, la repartie pouvait surprendre et fragiliser les évidences sur lesquelles on fonde si souvent ses opinions. Sous couvert d’abolir l’hiver, il a rappelé les mérites de la saison qu’on met tant d’efforts à dénaturer et à détester. Je l’entends aussi relater une soirée de baseball à San Francisco, ramenée pour le coup à la personne du joueur de champ droit Barry Bonds, aux genoux de Barry Bonds, à l’économie (étymologiquement : « administration de la maison ») des genoux de Barry Bonds. Artefacts, sport, stade, foule entonnant Take Me out to the Ball Game, tout était chez lui prétexte à interprétation. Lire Les Cuivas, c’est en somme aller à l’origine d’une féconde attitude intellectuelle.
La formation ethnologique prévoit qu’après les gros livres on se rende en terre étrangère se livrer à un exercice tenant du camping extrême et qui comporte sa part réelle de danger (marche interminable dans des marécages infestés d’une flopée de bibittes, de bestioles et de bêtes toutes plus dangereuses les unes que les autres). Une fois sur place, on se renseigne sur ce qui fait la vie de tous les jours de ceux qu’on désignera comme ses informateurs : manger, se loger, se vêtir (si peu que ce soit), dormir, avoir du chagrin, se geler la fraise, entrer en contact avec des étrangers, devenir adulte, se marier, avoir des enfants, être malade, raconter des histoires, rire, vieillir. On apprend la langue cuiva (environ 1 000 locuteurs au total), on pose des questions, on ne comprend pas tout, on insiste, on écrit une thèse savante (pardonnez le pléonasme), on retourne un an plus tard en livrer le contenu aux gens à qui l’on a soutiré de quoi composer plusieurs centaines de pages en essayant d’y faire tenir tout leur univers. Arcand s’en confesse : l’humilité du chercheur fut alors de mise.
Les Cuivas, c’est ça, mais un demi-siècle après le fait, sous forme de récit, livré dans une langue destinée à nous qui ne sommes pas anthropologues. « Les gens préfèrent les relations humaines immédiates, les histoires de flirt, les stratégies matrimoniales, les magouilles et les rancœurs, aux analyses formelles des réseaux de parenté. » Cela vaut pour nous, enfants des bibliothèques, comme pour les enfants de l’Ariporo, de la zone où l’Orénoque flirte avec l’Amazone. Je ne dirai pas que cet ouvrage se lit comme un roman (l’auteur désapprouverait l’usage du cliché, à raison), mais peut-être comme une fiction, une histoire exotique au maximum, dont la toponymie (Mochuelo, Casanaré, Agua Clara…) est une porte donnant sur le rêve, avec derrière elle des Guahibos, Sikuanis, Homoas et autres peuples. Une fiction, c’est-à-dire une histoire vraie, mais qui se déroule ailleurs et autrement qu’ici, avec d’autres codes : par exemple, la maladie vient avec le vent, en provenance de gens malfaisants vivant au loin. Lecteurs du Partage des eaux d’Alejo Carpentier ou d’Utopie sauvage de Darcy Ribeiro, il y a ici de quoi vous sustenter ! Lecteurs de Denys Delâge (Le pays renversé), vous éprouverez la même impression d’aventure intellectuelle globale.
Un rêve évanoui
Le jeune Arcand visait les îles Nicobar, dans l’océan Indien, mais les circonstances et son intérêt pour les chasseurs-cueilleurs l’auront plutôt amené du côté des llanos de la Colombie, loin à l’intérieur, dans une zone à l’époque encore peu visitée. Laissons-nous porter encore par les mots nés entre saison sèche et saison des pluies (les llanos, ces plaines herbeuses, c’est déjà des images, un sentiment d’isolement), par le mouvement des nomades dans un monde où bientôt ils ne seront plus qu’un souvenir, par l’indéfinissable impression que, sous ces lointaines latitudes, il pourrait y avoir des peuples inconnus. L’anthropologie est un rêve, l’anthropologie naît d’un rêve, d’un rêve éveillé : les Cuivas ont existé, mais leur univers n’existe plus, nous disent les préfaciers. Les temps modernes reprennent ad nauseam Le dernier des Mohicans.
L’anthropologie pourrait en effet tourner au cauchemar : et si la description précise d’un groupe dans son environnement permettait à des exploiteurs de les circonvenir, de les exiler ou d’en faire des exilés sur leur propre territoire ? Les capybaras ne suscitent pas la convoitise, certes, mais le pétrole ? Ce n’est pas pour rien que l’El Dorado s’est toujours dérobé. Des nomades, ça se sédentarise ; une plaine, ça se cultive ; la guérilla, ça prend le bois ; des brigades paramilitaires, ça traque les guérilleros. Une thèse de doctorat, ça se lit, sauf si l’auteur prend des dispositions (dignes d’un roman d’espionnage) pour la soustraire à la consultation, ce que le jeune docteur a fait. Puis le temps passe, le monde décrit par l’anthropologie classique s’évanouit, et l’envie de parler des Cuivas, c’est-à-dire d’un monde, s’impose. L’anthropologie est un souvenir.
Anthropologie, le mot m’est cher.
Un anthropologue moins jeune
Entre le silence et la parole, entre la thèse d’autrefois et le livre de maintenant, s’est sans doute glissée l’expérience générale de l’auteur, qui est affaire de recherches et de vie personnelle, si bien qu’on constate vite que Les Cuivas a une portée polyphonique. Il y est question d’une bande, de ses déplacements, de sa manière de composer avec l’existence, de concilier le féminin et le masculin, le sec et l’humide, les légumes et la viande, les déplacements et les escales, le quotidien et la réalité augmentée qu’est le mythe. L’anthropologue ne fait pas comme s’il n’était pas là, il lui arrive même, à force d’interrogations, d’être fatigant pour ses hôtes (devant l’inconnu, un bon narrateur ne cache ni son désarroi ni ses maladresses). Et il y a nous qui regardons par-dessus l’épaule du chercheur et qui prenons conscience du propos sur l’anthropologie elle-même, placé en sous-couche.
En adoptant la forme générale du récit, l’auteur aura rapproché ses lecteurs de l’enjeu, du grand jeu : nous ne sommes pas dans un amphithéâtre du Collège de France ou de l’Université Laval à recevoir un cours, si bien donné soit-il, mais près de l’anthropologue sur le terrain, tantôt dans la pirogue ou dans le hamac, tantôt dans son carnet de notes, point de rencontre de son observation et de ce que lui ont appris les gros livres, mais essentiellement à un bras de distance, à une phrase de ses informateurs.
On est en 1969. Quand on y pense, la méthode structurale n’est pas si vieille : Lévi-Strauss a fait paraître Anthropologie structurale en 1958 et Le cru et le cuit en 1964. C’est dans le plus pur esprit structuraliste que le jeune chercheur se prêtera à l’analyse de mythes, notamment d’une histoire comme il en arrive in illo tempore : au début des temps il n’y avait que le jour et les hommes portaient des médaillons de glaise séchée que les femmes trouvaient bien laids. Sauterelle, fourmi noire, martin-pêcheur et libellule se mettent de la partie, le ciel se fracture, il y a une grande dévoration. La cosmogonie est à ce prix, mais comment s’y retrouver ? On n’est ni à Oxford ni au Collège de France, mais dans des lieux que ne dédaignent ni les piranhas ni les anacondas. Cela (et la suite pour Falardeau) : un gars descend de son hamac et entreprend d’expliquer tout le bazar. Appartenir à une culture n’exige pas qu’on l’interprète, qu’on devienne l’anthropologue de soi-même, mais ça n’interdit pas non plus qu’on s’y connaisse ! De même, tout locuteur d’une langue, nous rappelle Arcand, sait s’en servir sans nécessairement savoir comment elle fonctionne – distinction qui appartient aux linguistes. Derrière les Lévi-Strauss, Mauss et autres Griaule de notre bout du monde, derrière le progrès fulgurant qu’ils ont permis dans l’étude des humains, il y a des Caduveos, des Bororos, des Dogons, des informateurs anonymes, de simples gens.
La théorie et la pratique
La pratique et la théorie ne s’opposent pas. Elles sont plutôt engagées dans une course à relais. La mise en forme d’un Aristote, d’un Jakobson, d’un Greimas est indispensable ; la vision du monde du dernier des Mohicans, tout autant. J’ai peur qu’on n’accorde plus d’attention ni à l’une ni à l’autre – d’où mon bonheur de lecteur devant ce récit, cette aventure d’un homme qui s’ennuyait de sa blonde, d’un homme au milieu des humains. Et ces questions : qu’est-ce qu’être pauvre ? qu’est-ce qu’être vieux ? Et une réponse comme celle-ci : « On peut être Cuiva et vivre vieux. Néanmoins il n’y a pas de vieillesse dans cette société ».
Bernard Arcand ne cède pas à l’envie (on la sent très forte de ma part !) de nous présenter les Cuivas comme un miroir sans tain, une surface réfléchissante dans laquelle nous n’aimerions rien tant que nous y reconnaître… sans toutefois y arriver. Quelle jouissance en effet quand l’être moderne se retrouve dans ceux qu’on a longtemps appelés les primitifs ! Quel bonheur, si enfoui, si secret soit-il, de retrouver en soi ce qui dans l’humain défierait l’histoire, l’évolution, voire une certaine déshumanisation. Mais cela est affaire de lecteurs.
Pour cela, il fallait que paraisse Les Cuivas. Une fois publiés, les livres appartiennent à ceux qui les lisent.
1. Bernard Arcand, Les Cuivas. Une ethnographie où il sera question de hamacs et de gentillesse, de Namoun, Colombe et Pic, de manguiers, de capybaras et de yopo, d’eau sèche et de pêche à l’arc, de meurtres et de pétrole, de l’égalité entre les hommes et les femmes, Lux, Montréal, 2019, 368 p. ; 34,95 $.











