Il arrive qu’à force d’entendre répéter des faussetés, on rêve de crier au monde entier : « Vous êtes dans les patates, je vais vous la dire, moi, la vérité ! » C’est le luxe qu’Anne-Marie Beaudoin-Bégin s’est payé avec sa trilogie d’essais sur la langue, et en particulier le petit dernier, La langue racontée1. On sent que ça lui a fait du bien.
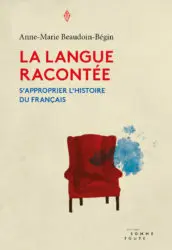 Le point de départ : les Québécois sont complexés par rapport à leur langue. C’était le sujet de La langue rapaillée (2015). En effet, beaucoup ont l’impression de « parler mal », notion qui horripile l’auteure. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas parler mal. Toute langue est parlée telle quelle par une communauté linguistique, et toute langue est essentiellement conventionnelle. L’idée qu’on puisse mal parler une langue découle de l’établissement d’une norme qu’« on » veut présenter comme absolue. Mais qui, « on » ? Forcément, les gens au pouvoir. Et les autres, pour Anne-Marie Beaudoin-Bégin, achètent un peu trop vite l’idée.
Le point de départ : les Québécois sont complexés par rapport à leur langue. C’était le sujet de La langue rapaillée (2015). En effet, beaucoup ont l’impression de « parler mal », notion qui horripile l’auteure. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas parler mal. Toute langue est parlée telle quelle par une communauté linguistique, et toute langue est essentiellement conventionnelle. L’idée qu’on puisse mal parler une langue découle de l’établissement d’une norme qu’« on » veut présenter comme absolue. Mais qui, « on » ? Forcément, les gens au pouvoir. Et les autres, pour Anne-Marie Beaudoin-Bégin, achètent un peu trop vite l’idée.
Donc, le premier mythe à combattre, c’est que la langue française serait une et indivisible, qu’elle nous serait tombée du ciel par la grâce du Saint-Esprit et qu’il appartiendrait à tous ceux qui prétendent la parler d’apprendre une série de règles (lexicales, grammaticales, syntaxiques, morphologiques et phonétiques) pour la parler autrement que ce qu’ils feraient spontanément.
Et la meilleure façon de démonter le mythe d’une langue immuable, c’est de raconter l’évolution de cette langue.
Une synthèse historique
Anne-Marie Beaudoin-Bégin réussit ainsi à résumer en une petite centaine de pages l’histoire du français depuis le latin jusqu’à nos jours. Elle le fait avec un esprit de synthèse remarquable, en apportant même des éclairages nouveaux, et dans une optique efficacement vulgarisatrice.
Par exemple, tout le monde sait que le français vient du latin. Mais « comment peut-on dire que le français vient du latin ? Est-ce comme lorsqu’on dit que la laine vient des moutons? » Et de fait, cette idée que tout le monde tient pour acquise sans trop s’être arrêté au comment, Anne-Marie Beaudoin-Bégin l’expose concrètement. D’abord en expliquant qu’il n’y a pas eu un latin, mais des latins. Cela lui permet de développer un des thèmes qui lui sont le plus chers, soit la variabilité linguistique. Car comme il n’y a pas eu un latin, il n’y a pas un français. Il y a des français, et, rappelons-le, ils sont tous corrects, donc votre français est correct, ligne de fond de l’ensemble de l’œuvre, comme nous l’avons précisé d’emblée. « Disons-le franchement : le français québécois est la variation d’une langue qui n’accepte pas la variation. Lourd bagage. »
Les grandes étapes de cette histoire sont ensuite décrites avec clarté et cohérence : le XVIe et sa langue libre et foisonnante, le XVIIe où les snobs se sont emparés de la langue, le XVIIIe triomphant où les Français ont eu l’outrecuidance de porter leur langue aux nues, puis le XIXe où on s’est employé à étouffer toute variation. Suit un court historique particulier pour le français canadien/québécois, toujours arc-bouté contre une norme déshonorante.
Quelques mythes déconstruits
Dans la foulée, Beaudoin-Bégin s’attaque à divers lieux communs, s’adressant aussi bien aux érudits qu’au grand public. Aux premiers, elle rappellera que la fameuse enquête de l’abbé Grégoire (1794) sur laquelle on s’appuie encore aujourd’hui pour tracer le portrait de la langue en France dans la foulée de la Révolution ne comportait en fait que 49 réponses, obtenues d’ailleurs dans des conditions discutables.
Les idées préconçues ayant cours dans la population générale en prennent aussi pour leur rhume. Ainsi l’idée selon laquelle les Québécois parleraient le français du XVIIe siècle. La réalité, rappelle la linguiste, c’est que le français québécois a conservé des mots et des prononciations qui ont disparu en France… mais il en a aussi inventé beaucoup d’autres, et dans le même temps, la France a elle-même conservé une pléthore de mots du XVIIe siècle (évidemment !). « Il y a très certainement des mots qui sont encore utilisés en France, mais qui ne sont plus utilisés au Québec. Mais il ne vient à l’esprit de personne de dire que la France utilise de ‘vieux mots’ ou qu’elle parle un ‘vieux français’ […] ! » C.Q.F.D. : Tout dépend par quel bout de la lorgnette on regarde !
Ce qui nous amène au fameux « Le roé, c’est moé », phrase que tous les Québécois ont prononcée un jour ou l’autre, en l’attribuant à Louis XIV, pour faire valoir le fait que celui-ci parlait comme eux. En fait, la prononciation n’est pas vraiment en cause ici, mais Beaudoin-Bégin signale que rien ne prouve que le Roi-Soleil ait prononcé cette phrase, d’autant plus qu’un monarque absolu n’a pas besoin d’affirmer une telle chose. Il serait plus plausible que la phrase ait été prononcée par Louis XVIII, de retour sur le trône après la Révolution, et qu’on l’ait alors repris sur sa prononciation, celle-ci étant dorénavant considérée comme réactionnaire. De l’aveu même de l’auteure, cette autre hypothèse n’est pas solidement étayée, mais elle est plus plausible, et de toute façon, l’amorce de correction vaut le détour.
Parmi les autres lieux communs auxquels l’auteure administre une correction, il y a la légende récurrente selon laquelle il serait désormais possible d’écrire « des chevals », ou l’idée bizarrement répandue, aussi, qu’un projet ne puisse pas « marcher » parce qu’il n’a pas de jambes. Pour se convaincre de la fausseté de cette dernière idée, il suffit d’ouvrir Le Petit Robert, qui fait remonter le sens figuré de ce mot au XVIIe siècle. Et notre linguiste descriptiviste de préciser : « Je n’aime pas justifier la pertinence d’une expression par sa présence dans un ouvrage de référence, mais comme les gens qui reprennent les autres le font, je pense que cette information est importante. »
Il y a aussi l’idée que la langue serait en train de se dégrader par les textos et autres moyens de communication modernes. Pour clore la discussion, Beaudoin-Bégin cite les résultats d’une étude française de 2014 où l’on a pu constater « que les enfants qui utilisent le langage SMS ont les mêmes compétences orthographiques que leurs pairs [et] que les enfants utilisateurs du SMS et les enfants ne l’employant pas usent du lexique avec la même diversité ». Autre mythe déboulonné.
La question de fond
On est donc ici en présence d’un livre divertissant, pertinent et accessible, apte à décomplexer le Québécois conformément à son projet premier. Le peuple doit reprendre sa place, et il la reprendra. On peut toutefois se demander s’il est nécessaire, pour valoriser les uns, de dévaloriser les autres. Certes, la langue française a été façonnée, principalement du XVIIe au XIXe siècles, par des intellectuels qui étaient fiers de leur langue, qui étaient fiers de la voir rayonner dans le monde et qui n’hésitaient pas à faire un lien entre ce rayonnement et ses qualités intrinsèques. Aujourd’hui, tandis qu’on valorise la fierté chez les humbles, on n’hésite pas à l’amalgamer à la vanité chez les puissants. On pourrait s’interroger sur ce deux poids deux mesures. Certes, il y a lieu de battre en brèche l’idée que le français québécois serait une « variation inférieure » de la langue de l’Hexagone. Serait-il possible, toutefois, tout en faisant cela, de reconnaître que la langue française n’est pas seulement le résultat d’une évolution spontanée et populaire, mais aussi le fruit d’un travail conscient qui avait pour but de tirer la pensée vers le haut, qui découlait non pas nécessairement d’une volonté d’avilir le peuple mais simplement d’un idéal intellectuel et esthétique auquel nous pourrions tous nous identifier et que nous pourrions tous vouloir perpétuer, peu importe notre niveau d’érudition ? Au regard d’un idéal d’ouverture, traiter les artisans historiques de notre langue de « vieux bonzes à perruque » n’est pas forcément plus constructif pour la collectivité francophone que de mépriser le petit peuple qui parle cette langue – ou une variante de celle-ci.
Il est d’ailleurs révélateur que l’auteure cite en exergue un Victor Hugo faisant valoir que l’évolution de la langue est inévitable. Car Hugo fut un des auteurs qui fit briller le plus la langue française par son érudition et son souci du mot juste. C’est l’écrivain par excellence pour nous rappeler qu’ouverture sur la nouveauté ne rime pas avec paresse intellectuelle.
Provoquer raisonnablement
Cela dit, Beaudoin-Bégin, malgré son parti pris résolu, sait afficher un certain pragmatisme face à ses propres élans. Un peu comme Voltaire à la fin de Candide, la linguiste avoue son impuissance devant la réalité du monde tout en préconisant une attitude sage et réaliste, quand elle regrette par exemple que les autorités n’aient pas procédé à une simplification de l’orthographe avant que l’école ne se mette historiquement à apprendre à tout le monde à lire et à écrire : « Quand on sait d’où viennent ces règles, on ne peut empêcher ce petit sentiment de dégoût. Il est trop tard, à mon avis, pour changer les règles elles-mêmes. Mais peut-être pourrait-on changer l’attitude par rapport aux règles ? »
1. Anne-Marie Beaudoin-Bégin, La langue racontée. S’approprier l’histoire du français, Somme toute, Montréal, 2019, 150 p. ; 16,95 $.
EXTRAITS
Ce livre, c’est, en quelque sorte, la flèche entre le latin et le français. Et on verra que cette flèche, contrairement à ce qu’on peut représenter, n’est ni très droite, ni très claire.
p.18
Il était, à l’époque [XVIe siècle], de bon ton de mélanger de l’italien à son discours (ce qu’on appellerait aujourd’hui probablement du fritalien, à l’instar du franglais) […].
p. 58
Encore aujourd’hui, il n’est pas rare de lire que 80 % de la population de la France prérévolutionnaire ne parlait pas français. Personne ne semble remettre en question ce chiffre, ou s’interroger sur la manière dont il a été obtenu. Il vient vraisemblablement de l’enquête de Grégoire, qui, sans autre forme de procès, a affirmé « sans exagération » et sur la base de 49 réponses issues du jugement de gens plus ou moins éclairés quant à la manière de parler de leurs voisins, que 6 millions de Français, en 1794, ne parlaient pas français.
p. 92-93
Aujourd’hui, le mot joual est encore utilisé. Mais il a changé de paradigme. […] Il n’est plus le symbole de la prise de parole des classes défavorisées. S’il est un symbole, il est celui de la prise de parole des gens qui sont fatigués qu’on critique leur manière de parler.
p. 119










