Août 1944. La guerre s’achève mais des bombes atomiques y apposeront un double point final d’horreur. Le monde est à refaire.
André Breton vit à New York depuis 1940. Il y a reconstitué un petit groupe d’écrivains et d’artistes mais il n’est pas à l’aise dans la grande ville anglophone. Il y vit le drame soudain : sa compagne le laisse pour un autre homme, emmenant avec elle leur fillette. Breton tombe dans la dépression et il n’est en lui, dit-il, que « ruines ».
Mais miraculeusement, on pourrait dire « surréalistement », se présente une femme très belle, Élisa, pour sa part blessée par la mort de sa fille. Breton s’enflamme. Le couple décide de franchir la frontière et d’aller en Gaspésie. Ils séjournent tout un mois à Percé. Le registre de l’hôtel où ils sont descendus, conservé et exposé, l’atteste par la signature de Breton.
Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Quel sens prend-il pour lui ? On peut avancer des réponses immédiates : s’éloigner de la métropole américaine, chercher le silence et la nature, se refaire des forces, vivre le grand amour.
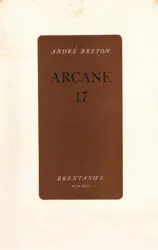 Breton entreprend alors d’écrire Arcane 17. Ce n’est pas, bien sûr, un journal rapportant le quotidien du séjour : Breton déteste et réprouve une aussi morne et paresseuse écriture. On connaît la condamnation du roman qu’il lançait dans ses deux Manifestes du surréalisme – source de tension avec Aragon finalement converti à ce genre et auteur prolifique. Donc refus de la narration, ce qui déconcerte immédiatement le lecteur, qui pouvait s’attendre à un récit circonstancié du séjour gaspésien insolite dans son contexte. Pourquoi avoir ouvert le texte par cette phrase : « Dans le rêve d’Élisa, cette vieille gitane qui voulait m’embrasser et que je fuyais, mais c’était l’île Bonaventure, un des plus grands sanctuaires d’oiseaux de mer qui soient au monde » ? Étrange assemblage d’éléments sans lien manifeste. Mais, on le sait, c’est le propre du surréalisme d’établir des collisions d’objets disparates d’où jaillit un sens inattendu, voire une révélation. Image de rêve, certes, mais celui-ci est attribué à Élisa et appelle étrangement un rapport avec une bohémienne vue par Breton et qui est l’île Bonaventure !
Breton entreprend alors d’écrire Arcane 17. Ce n’est pas, bien sûr, un journal rapportant le quotidien du séjour : Breton déteste et réprouve une aussi morne et paresseuse écriture. On connaît la condamnation du roman qu’il lançait dans ses deux Manifestes du surréalisme – source de tension avec Aragon finalement converti à ce genre et auteur prolifique. Donc refus de la narration, ce qui déconcerte immédiatement le lecteur, qui pouvait s’attendre à un récit circonstancié du séjour gaspésien insolite dans son contexte. Pourquoi avoir ouvert le texte par cette phrase : « Dans le rêve d’Élisa, cette vieille gitane qui voulait m’embrasser et que je fuyais, mais c’était l’île Bonaventure, un des plus grands sanctuaires d’oiseaux de mer qui soient au monde » ? Étrange assemblage d’éléments sans lien manifeste. Mais, on le sait, c’est le propre du surréalisme d’établir des collisions d’objets disparates d’où jaillit un sens inattendu, voire une révélation. Image de rêve, certes, mais celui-ci est attribué à Élisa et appelle étrangement un rapport avec une bohémienne vue par Breton et qui est l’île Bonaventure !
Le lecteur immédiatement en porte-à-faux perd pied, et il n’est pas au bout de ses peines et sa réaction est naturelle : où Breton veut-il en venir ? Provocation, dont il est coutumier ? Cependant surgissent des allusions dont l’objet est identifiable : les oiseaux, les dessins qu’ils forment sur la pierre du rocher, un bateau à voile conduisant à l’île. Breton (qui n’a rien d’un maître de l’humour ou du comique !) s’amuse à noter des particularités du parler canadien-français et il ne manque pas de souligner que « l’Église catholique, fidèle à ses méthodes d’obscurcissement », use de son pouvoir dans la province. Puis il parle de drapeaux rouges ou noirs, des siècles passés, de Paris libéré. On comprend mieux : le texte ne relève pas d’un ordre logique – il serait donc vain de l’y chercher – mais de la rêverie, sinon du fantasme. Il en suit le mouvement, fixe les images comme elles se présentent dans leur succession spontanée, leurs analogies, leurs associations, leurs surimpressions : marques spécifiques de la parole poétique aux yeux de Breton.
Et cette rêverie est induite par des objets extérieurs : le rocher Percé, l’île, les fous de Bassan, qui existent ici ou ailleurs, dans la perception immédiate ou bien dans la mémoire. Entrelacs, ou kaléidoscope si l’on veut, mais dans lequel on peut postuler l’existence d’une direction, si inconsciente soit-elle. Différents niveaux de la vision intérieure se superposent : ainsi le rocher par ses failles et ses stries soulignées par la blancheur des oiseaux, comme par une « écume », devient une écriture à déchiffrer (elle livrera peut-être même « le nombre d’or », clef de la beauté…), par sa géologie elle devient histoire.
Parfois le texte décolle sans ambiguïté du présent concret et sensible et, même si les enchaînements ne vont pas tous de soi, la pensée de Breton s’oriente vers des perspectives futures : un rajeunissement, voire une reconversion « de fond en comble » des valeurs collectives qui ont fait faillite pendant la guerre. Dans l’orifice du rocher, Breton voit étonnamment apparaître la vieille Europe aimée et martyrisée. Il lance des jugements sur les fausses gloires – tel La Fontaine – qui encombrent les manuels d’histoire. En regard de cela, il loue la « fraîcheur » du douanier Rousseau et du facteur Cheval, jette au passage un œil sur Le silence de la mer de Vercors. De façon plus claire, il s’interroge sur le travail à faire pour « effacer de l’esprit des hommes les grandes cicatrices collectives et les souvenirs lancinants de ces temps de haine ». En conséquence, il appelle à la révision globale des idées reçues par le recours (que le lecteur pouvait attendre !) aux « grands aventuriers de l’esprit », Paracelse, Rousseau, Sade, Lautréamont, Freud, Marat, Saint-Just. En d’autres termes, il faut remplacer les idées reçues d’une fausse culture par l’aspiration à la beauté, à la vérité, à la bonté, triade dont il ne cesse de proclamer la valeur suprême.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, le surgissement anarchique des images s’apaise, faisant place à un propos plus rassis. Paraît une figure neuve qui va le polariser : Mélusine, c’est-à-dire la femme perdue et retrouvée, victime de la guerre ; la femme-enfant qu’elle est aussi peut « rédimer » l’époque, car elle porte en elle « un autre prisme de vision ».
Avec elle se combine une autre figure féminine, celle que représente la lame XVII du tarot. Voilà enfin l’explication du titre ! Sous un ciel d’étoiles une femme nue agenouillée puise à deux ruisseaux, l’un associé (curieusement) au feu, l’autre à l’eau. Breton leur prête des monologues prolongés par des poèmes, ce qui souligne, si besoin en était encore, la forme multiple et éclatée de l’ouvrage. Alternent un discours délibérément poétique et des considérations sur l’époque. La guerre, outre ses dévastations, a provoqué une perte du sens critique qu’il faut restaurer. Breton insiste : la femme devrait trouver une place plus grande, plus influente, et même avoir préséance sur la pensée masculine jusque-là toute-puissante, car elle répand « la jeunesse éternelle ». Ce programme s’entrelace avec des considérations sur le mythe d’Isis et de larges visions de l’Égypte pharaonique. L’occasion pour Breton d’introduire dans son exposé l’ésotérisme. Il en voit la marque partout présente dans la littérature, chez Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, poètes-inspirateurs qui doublent les poètes-penseurs nommés plus haut, qui ont su découvrir la mécanique du symbolisme universel reposant sur des correspondances omniprésentes dans tout ce qui existe.
Breton en vient à formuler deux désirs, ce qui constitue l’aboutissement et même la raison d’être d’Arcane 17. Un vœu personnel : « qu’au-delà de la grande pitié des temps et mon désarroi propre, je recouvre l’intelligence poétique de l’univers ». Un autre pour que la restauration du monde se fasse dans l’esprit de résistance et de liberté. Le résumé se fait à la dernière page du livre dans le symbolisme explicite de l’étoile.
L’impression première se confirme par une lecture attentive : le livre donne la sensation d’un glissement, d’une instabilité totale en suivant des pentes imprévisibles, ce qui engendre une sorte de vertige. L’auteur, qui est lui-même en déséquilibre, met le lecteur en alerte. Pris sous cet angle, Arcane 17 semble se présenter comme une version nouvelle des Manifestes, un condensé des thèmes majeurs de leur auteur, voire un véritable testament spirituel.
Et la Gaspésie, dans ce tissu serré d’impressions, intuitions, rêves, paysages, souvenirs, proclamations ? Elle paraît finalement évacuée. Non pas. Le rocher Percé est célébré comme un lieu magique, générateur extraordinairement puissant d’images et d’intuitions. C’est lui qui fournit le tremplin de la pensée de Breton. Un lieu d’observation idéal, dit-il, ce terme n’étant pas pris dans son acception optique mais dans un sens second, Breton étant plus habitué à débusquer le mystère dans les quartiers de Paris qu’en pleine nature. Ainsi le rocher est une « nef » sur laquelle s’embarque sa pensée, ou une arche par laquelle est perçue une autre réalité. Et c’est bien ce que Breton est venu chercher secrètement : la Gaspésie, alliance de la mer et de la montagne d’une pureté originelle, est pour lui la rencontre qui enfin rend possible « un détour par l’essence », dont il se sentait cruellement privé. Il retrouve cette essence par la beauté, la poésie, l’amour. En termes plus simples, il espérait restaurer un état intérieur qui ne peut se nommer qu’un « état de poésie ». Si l’on en croit ce livre étonnant, il y est parvenu. Le rocher et l’île Bonaventure deviennent dans une véritable apothéose un lieu ailé par ses oiseaux qui s’envolent comme des messagers.
*Roland Bourneuf, écrivain et ancien professeur de littérature à l’Université Laval, a publié une quinzaine d’ouvrages dont Littérature et peinture(1998), Le traversier (2000), La route innombrable (2003), L’usage des sens (2004), Pierres de touche (2007 ; prix Victor-Barbeau 2008), L’ammonite (2009), Points de vue (2012), L’étranger dans la montagne (2017), Sentiers, sources. Carnets 1999-2008 (2019) et Vieillir. Chemin de vérité (2020).










