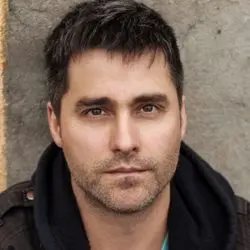On m’a dit que la Gaspésie, c’était un des endroits les plus pauvres du Québec, mais aussi là où les gens sont le plus heureux. La première fois que j’y suis débarqué, j’étais en pleine dérape, avec la métropole en moi. Montréal tourne le dos au fleuve… C’est ce que je connaissais. Montréal, ce n’est pas l’endroit le plus pauvre, mais ce n’est pas l’endroit où les gens sont le plus heureux non plus. Quand je suis débarqué en Gaspésie, je me rappelle m’être dit : « C’est tellement grand qu’on dirait que je vais disparaître. Tellement grand que c’est peut-être pas grave ». J’y retourne chaque année depuis vingt ans.
À l’époque, je m’époumonais à vivre. Halluciné, plaqué par l’immensité, par les rafales de la mer, je rejoignais un ami revenu y habiter. Il venait de rencontrer la mère de ses quatre futurs enfants dans une marche silencieuse. Des jours de temps à marcher en silence. Une marche Mi’gmaq.
On m’a dit que dans le Saint-Laurent, il y a plus de phoques qu’il y a de Québécois au Québec. On m’a aussi dit que la morue à une époque faisait des mètres de long. Il y a tellement de choses qu’on ne voit pas. Je n’avais jamais vraiment vu qu’au Québec, il y a d’autres nations que les deux solitudes. J’ai suivi mon ami. On a dépassé une station-service en forme de tipi, on a avancé un peu, il y avait cette église en forme de tipi elle aussi, et tout à coup mon Québec, cette Gaspésie qui me faisait tant de bien par son rythme, sa beauté et l’amitié facile de ses gens, ce monde était en trois dimensions. Je n’en suis jamais tout à fait revenu.
Sans le savoir, les Mi’gmaqs m’ont beaucoup appris. Nos villes, leurs rythmes, nos dieux, leurs pouvoirs, nos vies, leurs inconscients ; tout ça vient de l’autre côté de la grande mer. Or, il y a des gens ici qui ont développé une langue, une philosophie de vie, une spiritualité, une cosmogonie à partir de ce paysage qui m’habite, ce territoire qui, en tant qu’urbain, me sauve. Peu à peu, à force de les côtoyer, oui, souvent un brin intimidé, des éclats se sont brisés en moi. Des traces de cette autre vision du monde faisaient leur chemin. Cette vision du monde qu’on a tenté de tuer. Sans le savoir, ils ont changé mon rapport à la vie, et au territoire dont je crois avoir la responsabilité.
En plus d’abreuver 80 % de la population, le fleuve me transperce, m’ouvre les yeux, m’agrandit l’intérieur. En Gaspésie, il prend l’ampleur de sa force et devient mer. Quand on la regarde, cette mer, la vision devient périphérique, on trouve un point de fuite où se réfugier. Et les vagues applaudissent.

Je crois que la Gaspésie a ce pouvoir de laisser au vent et à l’horizon la chance de nous fendre, de faire de la place en nous, de la place pour aimer. Et je crois qu’elle a ce pouvoir entre autres parce qu’elle s’appelle aussi Gespe’gewa’gi. Parce que derrière son tourisme et ses plages, ses microbrasseries et ses parcs nationaux, il y a des gens qui savent où pousse le foin d’odeur, comment pensent les saumons, comment faire des paniers avec du frêne. Des gens qui savent écouter les aînés, entendre les histoires d’avant les chambardements. Depuis vingt ans, je les observe de loin restructurer leur communauté à la suite du génocide auquel ils ont survécu, je les vois lutter pour se décoloniser, pour guérir, pour retrouver leurs mots, leurs chants, leurs rituels, leurs rêves. Je les vois se relever de cet immense traumatisme et tenter de le faire à leur manière. C’est impressionnant. Je trouve dans cette renaissance et ces rituels une grille de lecture plus appropriée au paysage qui m’entoure et aux enjeux qui découlent de sa protection, de sa décolonisation. Et peu à peu, je me sens plus à ma place. Vivre avec un mode de vie qui vient d’ailleurs fait pression sur nous, nous pousse, nous force à entrer dans un cadre qui ne vient pas d’ici. Simplement avoir contact avec une vision du monde née sur ces terres enlève du poids sur mes épaules.
J’y trouve du réconfort. De la dignité. Du sens et de la beauté.
M’st no’gmaq. À toutes mes relations.