Le saut en politique de Jean-François Lisée, chef du Parti québécois de 2016 à 2018, s’est plus ou moins terminé en cul-de-sac. Mais l’homme a plus d’un tour dans celui-ci. C’est ainsi que cette fatalité a amené l’ancien journaliste à reprendre la plume, pour le plus grand bonheur du lecteur. Car Lisée s’avère un formidable conteur.
Lisée a lancé « La boîte à Lisée », un site Web qui regroupe blogue, balados, calendrier de conférences et livres publiés à compte d’auteur. Ceux-ci comprennent une collection intitulée « Jean-François Lisée raconte », dans laquelle l’auteur se propose de « plonge[r] le lecteur dans des épisodes marquants de l’histoire du Québec moderne ». Ses deux premiers sujets piquent certainement la curiosité : la passion trop peu connue du général de Gaulle pour l’indépendance du Québec1, et l’intérêt encore moins connu du président John F. Kennedy pour le même projet2. « La boîte à Lisée » publie aussi un récit des deux années politiques de l’auteur mêlé à une réflexion sur l’interaction entre politique et médias3.
De Gaulle, l’indépendantiste
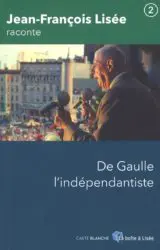 Au lendemain du fameux « Vive le Québec libre ! » lancé par de Gaulle à Montréal le 24 juillet 1967, « la plupart des commentateurs [québécois] refusent de franchir le pas et de considérer que de Gaulle soutient l’indépendance du Québec ». Alors que la presse anglophone ne s’y trompe pas, on voudra faire de cette phrase un mystère pendant de nombreuses années au Québec. Quand on a lu l’ouvrage de Lisée, cet aveuglement a de quoi faire rire… ou pleurer. Car l’intérêt de de Gaulle pour le Québec, sa conviction que celui-ci pourrait et devrait un jour ou l’autre accéder à la souveraineté, remonte à très loin, et il l’a affirmée sans ambiguïté, avant comme après sa fameuse exclamation. Dans un récit enlevant, Lisée nous en refait toute l’histoire, depuis le parallèle que traçait déjà le général entre la « Nouvelle-France conquise » et la France occupée dès la Deuxième Guerre mondiale. En effet, qui sait que quelques semaines à peine après l’appel du 18 juin, le général s’est adressé, le 1er août 1940, aux Canadiens français sur les ondes de Radio-Canada en leur affirmant – évoquant l’occupation de la France par l’ennemi – que « personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français » et que la France « trouve dans [leur] exemple de quoi ranimer son espérance et son avenir puisque, par [eux], un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique » ?
Au lendemain du fameux « Vive le Québec libre ! » lancé par de Gaulle à Montréal le 24 juillet 1967, « la plupart des commentateurs [québécois] refusent de franchir le pas et de considérer que de Gaulle soutient l’indépendance du Québec ». Alors que la presse anglophone ne s’y trompe pas, on voudra faire de cette phrase un mystère pendant de nombreuses années au Québec. Quand on a lu l’ouvrage de Lisée, cet aveuglement a de quoi faire rire… ou pleurer. Car l’intérêt de de Gaulle pour le Québec, sa conviction que celui-ci pourrait et devrait un jour ou l’autre accéder à la souveraineté, remonte à très loin, et il l’a affirmée sans ambiguïté, avant comme après sa fameuse exclamation. Dans un récit enlevant, Lisée nous en refait toute l’histoire, depuis le parallèle que traçait déjà le général entre la « Nouvelle-France conquise » et la France occupée dès la Deuxième Guerre mondiale. En effet, qui sait que quelques semaines à peine après l’appel du 18 juin, le général s’est adressé, le 1er août 1940, aux Canadiens français sur les ondes de Radio-Canada en leur affirmant – évoquant l’occupation de la France par l’ennemi – que « personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français » et que la France « trouve dans [leur] exemple de quoi ranimer son espérance et son avenir puisque, par [eux], un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique » ?
En 1960, il force la main du nouveau gouvernement de Lesage en instituant la Maison du Québec à Paris.
C’est en fait un long fil d’Ariane que nous déroule Lisée pour illustrer la foi du général dans l’émancipation du Québec, jusqu’à ce fameux coup de tonnerre de 1967 – dont la portée ne lui échappait nullement – et même après, lorsqu’il propose – par l’intermédiaire de son ministre Peyrefitte –, à un Daniel Johnson effarouché, des rencontres au sommet des gouvernements français et québécois devant avoir lieu tous les six mois en alternance, comme la France le faisait avec l’Allemagne. Daniel Johnson, qui se remet d’une crise cardiaque, porte sa main au cœur. « Tout ça va trop vite ! Trop vite ! Nous sommes un peuple de paysans. »
Tendant sa solide main de grand frère à un pays adolescent, de Gaulle aura été le boutefeu d’un pétard mouillé.
La tentation québécoise de John F. Kennedy
L’histoire que raconte Lisée à propos de John F. Kennedy est encore plus inattendue. Dans un pays où l’idée même de sécession est synonyme du plus grand traumatisme qu’on puisse imaginer pour un pays, comment un président en est-il arrivé à cultiver ce qu’on pourrait appeler un « préjugé favorable » pour l’idée de l’indépendance québécoise, encore embryonnaire dans les années 1950 ?
Le trait d’union, c’est un nommé Armand Morissette, simple curé de Lowell (Massachusetts), au cœur d’une communauté encore très vivante de Canadiens français installés en Nouvelle-Angleterre à la fin du siècle précédent à la recherche de travail dans les manufactures.
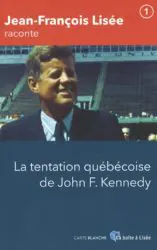 En effet, pour accéder à la présidence des États-Unis, Kennedy souhaite passer par le Sénat. Et pour obtenir son siège de sénateur démocrate, il a besoin du vote de l’importante communauté canadienne-française du Massachusetts, laquelle a plutôt tendance à voter républicain avec la bénédiction de son influent curé. D’où les rapprochements stratégiques que tentera graduellement le francophile clan Kennedy avec l’homme de Dieu. C’est ainsi que ce pasteur, farouchement nationaliste avant l’heure, aura eu l’oreille attentive – pour ne pas dire captive – du futur président, qui se laissera toucher par la destinée possible de ce peuple francophone conquis et oublié au nord de son pays. Son intérêt pour l’indépendance encore récente de l’Irlande a certainement joué sur son esprit d’ouverture, mais aussi, comme le dit le diplomate américain Charles Bohen : « C’est un des hommes les moins encombrés de préjugés qu’il m’ait été donné de rencontrer ».
En effet, pour accéder à la présidence des États-Unis, Kennedy souhaite passer par le Sénat. Et pour obtenir son siège de sénateur démocrate, il a besoin du vote de l’importante communauté canadienne-française du Massachusetts, laquelle a plutôt tendance à voter républicain avec la bénédiction de son influent curé. D’où les rapprochements stratégiques que tentera graduellement le francophile clan Kennedy avec l’homme de Dieu. C’est ainsi que ce pasteur, farouchement nationaliste avant l’heure, aura eu l’oreille attentive – pour ne pas dire captive – du futur président, qui se laissera toucher par la destinée possible de ce peuple francophone conquis et oublié au nord de son pays. Son intérêt pour l’indépendance encore récente de l’Irlande a certainement joué sur son esprit d’ouverture, mais aussi, comme le dit le diplomate américain Charles Bohen : « C’est un des hommes les moins encombrés de préjugés qu’il m’ait été donné de rencontrer ».
Car le terreau états-unien était moins que favorable. Nous l’avons dit : l’idée de sécession est terrifiante pour tous les Américains (la guerre du même nom ne date pas encore de cent ans à l’époque), et de toute façon, la notion de nationalisme va à l’encontre du mythe structurant de la nation du melting-pot. Le préambule de Lisée, où il raconte comment les indépendantistes du Québec se sont lourdement trompés en pensant au départ que les Américains seraient sensibles à leur cause, est d’ailleurs particulièrement éloquent, voire touchant. Pour les Québécois – l’américanophile René Lévesque en tête –, le parallèle entre l’accession du Québec à l’indépendance et l’affranchissement des États-Unis de leur mère patrie britannique au XVIIIe siècle relevait de l’évidence, et il a fallu bien du temps et quelques brutales rebuffades pour se rendre compte qu’il n’en était rien dans l’esprit de nos voisins du Sud.
Pendant son court mandat de président, Kennedy se tiendra coi sur les velléités indépendantistes du Québec. Mais d’après ses proches conseillers, rien n’empêche de croire qu’il continuait à entretenir une certaine sympathie pour ce projet.
Qui veut la peau du Parti québécois ?
C’est sa propre histoire que raconte Lisée cette fois. Le titre accrocheur est à la fois révélateur et trompeur. Car s’il exprime bien un des fils conducteurs de l’ouvrage, à savoir l’acharnement apparent des médias à annoncer la mort du Parti québécois malgré des éléments factuels ne corroborant pas ce pronostic, il laisse croire à une certaine animosité de l’auteur qui, elle, ne transparaît pas vraiment dans son récit. « Je vais bien », tient-il à préciser d’emblée dans son avant-propos, faisant allusion aux multiples manifestations d’empathie qu’il reçoit régulièrement dans la rue et qui l’amusent un peu. Son expérience de chef du Parti québécois aurait pu connaître une fin plus glorieuse, et elle n’a pas été exempte de frustrations, mais l’ancien journaliste, s’il ne se gêne pas pour décocher quelques flèches à droite et à gauche, se donne surtout pour mission d’exposer la succession des actions et des événements qui ont jalonné son mandat et d’expliquer posément comment et pourquoi les journalistes n’ont pas toujours ramé dans le même sens que lui.
 C’est donc sans animosité – et même avec humour – qu’il le fait, allant même jusqu’à citer Jean Charest : « Un politicien qui se plaint des journalistes, c’est comme un poisson qui se plaint de l’eau ». En effet, après avoir dénoncé différents cas où les journalistes ont eu l’outrecuidance de suivre leur propre « fil narratif » plutôt que les faits, il rappelle que tous les partis ont probablement le même genre de récriminations à propos des médias, et tient à préciser que, « au total, et sachant que la perfection n’est pas de ce monde, les journalistes québécois font très correctement leur travail ».
C’est donc sans animosité – et même avec humour – qu’il le fait, allant même jusqu’à citer Jean Charest : « Un politicien qui se plaint des journalistes, c’est comme un poisson qui se plaint de l’eau ». En effet, après avoir dénoncé différents cas où les journalistes ont eu l’outrecuidance de suivre leur propre « fil narratif » plutôt que les faits, il rappelle que tous les partis ont probablement le même genre de récriminations à propos des médias, et tient à préciser que, « au total, et sachant que la perfection n’est pas de ce monde, les journalistes québécois font très correctement leur travail ».
Dans sa passionnante chronologie du cheminement du Parti québécois depuis le changement de chef (octobre 2016) jusqu’à l’élection perdue (octobre 2018), il est moins tendre, toutefois, envers Québec solidaire, dont la structure occulte – voire retorse – lui a fait perdre beaucoup de temps et d’énergie lorsque, avec son équipe, il a réussi à convenir d’une union stratégique pour l’élection avant que les « vrais chefs » de QS, surgissant de l’ombre, désavouent sans vergogne les engagements patiemment noués avec des Manon Massé, Andrés Fontecilla et Gabriel Nadeau-Dubois dont la grande visibilité et l’apparente influence se sont avérées de frêles paravents.
La revanche du style
« L’ombre de la politique québécoise de Charles de Gaulle a donc porté très, très loin. Il faut dire que l’homme était grand. » Comme rédacteur de discours et comme figure politique, Lisée a souvent dû se plier aux diktats des bonzes de la communication qui militent pour un nivellement par le bas, aussi bien des idées que de la langue. Libéré de ce carcan, il peut maintenant faire briller une plume qui n’a rien à envier aux meilleurs romanciers, qui plus est pour nous raconter des histoires vraies, parfois débusquées de la marge des projecteurs publics, solidement documentées et – comme en fait foi le format relativement modeste des trois ouvrages – dénuées de toute longueur.
1. Jean-François Lisée, De Gaulle, l’indépendantiste, Carte blanche/La boîte à Lisée, Montréal, 2020, 141 p. ; 15,95 $.
2. Jean-François Lisée, La tentation québécoise de John F. Kennedy, Carte blanche/La boîte à Lisée, Montréal, 2020, 99 p. ; 15,95 $.
3. Jean-François Lisée, Qui veut la peau du Parti québécois ? Et autres secrets de la politique et des médias, Carte blanche/La boîte à Lisée, Montréal, 2019, 227 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
Lorsqu’il a proclamé que les pays d’Indochine devaient pouvoir disposer d’eux-mêmes, il savait qu’il mécontenterait Washington, mais ses hôtes, au moins, allaient l’applaudir. […] Mais au Québec, qui l’applaudira ? Avant de débarquer du Colbert, il n’en sait rien.
De Gaulle, l’indépendantiste, p. 90.
La venue de Charles de Gaulle représentait pour les francophones du Québec, au complexe d’infériorité patent, économiquement dominés, linguistiquement opprimés, politiquement marginalisés, la reconnaissance, par un géant de l’histoire, de leur valeur. […] Non, jamais les Québécois n’avaient perçu dans le regard d’un autre la lueur de l’admiration.
De Gaulle, l’indépendantiste, p. 102-103.
Quelque part entre son élection au Sénat en 1952 et sa décision de briguer l’investiture démocrate de 1960, Kennedy donne raison au père Morissette. « Le Québec, comme l’Algérie, sera un pays », lui confie-t-il.
La tentation québécoise de John F. Kennedy, p. 63-64.
S’il en avait eu le temps, Kennedy aurait-il fini par faire d’une conviction personnelle une affaire d’État ? […] Il aurait pu faire le saut à l’occasion du « Vive le Québec libre ! » Dans son second mandat, entraîné par de Gaulle, il aurait pu jouer le cœur plutôt que la raison d’État. Il aurait pu crier à Montréal : « Ich bin ein Québécois ! »
La tentation québécoise de John F. Kennedy, p. 84-85.
Je me souviens en particulier de la semaine où nous avions tenu un point de presse par jour, très peu couvert, pour entendre des chroniqueurs affirmer que nous étions très absents…
Qui veut la peau du Parti québécois ?, p. 53.
Alors même que notre membership et notre mobilisation étaient de loin les plus forts, que mensuellement les chiffres du directeur général des élections attestaient de notre domination absolue en financement populaire, que nos salles étaient pleines, même pendant la saison des investitures de candidats, qu’un électeur sur cinq nous restait fidèle, il fallait admettre une chose, on nous tenait pour mourants.
Qui veut la peau du Parti québécois ?, p. 73-74.
Mais voilà, en juin 2018, il semblait impossible de nous rendre même au premier but, car on nous considérait généralement comme à l’article de la mort. Ce message sans cesse relayé se transforme en prophétie autoréalisatrice.
Qui veut la peau du Parti québécois ?, p. 82.









