« Monsieur le président, messieurs du Tribunal, déclara-t-elle, il m’échoit aujourd’hui un très rare privilège. »
Dans une langue claire et fière, maître Gisèle Halimi expliquera à la Cour, lors de l’ouverture du procès de Bobigny demeuré dans les annales aussi bien juridiques que politiques, qu’elle prendra la parole en tant que défenderesse de la cause et en tant que femme, dans un parfait accord entre un métier qui lui est accroché au cœur et une condition humaine qui l’est au corps. La cause : une jeune fille de seize ans, enceinte à la suite d’un viol, est dénoncée par son violeur (!) et accusée de l’acte illégal d’avortement. Détrompez-vous, ce n’était pas au Moyen Âge. Cela se passait en 1972, en France.
Ce procès sera la clé de voûte de la dépénalisation de l’avortement dans l’Hexagone, promulguée en janvier 1975, sous la férule de Simone Veil, peu après les États-Unis (1973), mais longtemps avant le Canada (1988). Cette victoire affûte, si besoin était, les trois instruments de la juriste pour changer le monde, à savoir le droit, l’insoumission, les mots. Car changer le monde est bien le moteur de sa longue vie, soutenu par la ferme conviction que « sa liberté n’a de sens que si elle sert à libérer les autres ».
Choisir la cause des femmes
En 1971, Halimi avait déjà fondé avec Simone de Beauvoir CHOISIR, mouvement de lutte en faveur de la légalisation de l’avortement. À l’instar de sa sœur d’armes, elle devait savoir que ce droit, même acquis de si rudes luttes, serait un demi-siècle plus tard menacé. Pas seulement en France. Aux États-Unis, en Pologne ou au Nouveau-Brunswick. La pasionaria des prétoires a l’habitude de prêter compétence et éloquence pour défendre « les victimes qui relèvent la tête, s’opposent et combattent », et pour attaquer les systèmes d’oppression, du colonialisme au sexisme, défendant le droit des peuples à l’indépendance ou dénonçant les actes de torture. Si elle se dresse contre le fait du prince, elle plaidera quand même la grâce présidentielle pour des condamnés à mort, insurgés politiques des indépendances tunisienne et algérienne, auprès de René Coty, qu’elle moque pour son ignorance des dossiers, et de Charles de Gaulle, qu’elle respecte malgré sa distance glaciale.
Au centre de ses multiples combats, celui des femmes, toujours. Dans une affaire emblématique qui marquera un tournant dans la guerre d’Algérie, celle de la jeune militante indépendantiste Djamila Boupacha, condamnée à mort après des aveux obtenus sous la torture, elle s’allie à Simone de Beauvoir et mobilise des gens de divers courants politiques, philosophiques, religieux. Parmi eux, Aimé Césaire, Germaine Tillion, Louis Aragon, René Julliard ou Françoise Sagan. En 1962, lors des accords d’Évian, Djamila sera amnistiée.
Gisèle Halimi n’aura de cesse de prendre fait et cause pour les femmes violées. Devant la coutumière défense du consentement de la victime, elle perd patience et un jour, excédée, apostrophe les membres du tribunal : « Une femme violée n’est honorable que morte ? Morte de s’être débattue ? » C’est en 1978, à Aix-en-Provence, que la justicière inscrira dans les annales « le procès du viol », qui mènera à sa criminalisation en 1980. Rien ne sera épargné aux deux victimes que des compères des violeurs, dépêchés au tribunal, traitent« de salopes, de gouines et d’enculées ». Une assistante est giflée. Une collaboratrice essuie un crachat. Halimi elle-même est frappée et menacée de mort. À son récit de la lourdeur, parfois de l’horreur, de ce procès, on se prend à penser que 40 ans plus tard, en entendant les échos de certains procès pour agressions sexuelles et viols au Québec, si les mœurs ont changé, les pratiques des tribunaux s’incrustent dans des modèles surannés et au total n’ont guère évolué.
L’enfance décide
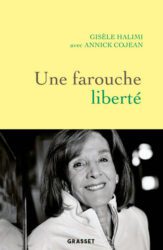 Jamais refus que le sexe nous assigne un destin n’aura été plus absolu que le sien. À dix ans, la fillette faisait la grève de la faim dans sa Tunisie natale, s’élevant contre le caractère injuste du traitement différencié des garçons et des filles dans la famille. « C’est pas juste », trois mots courroucés qui reviendront souvent dans sa bouche comme un rappel au combat. Les parents affolés ont cédé : elle n’aurait plus à servir ses frères ni à la table ni ailleurs ni jamais. « Et quand on lui oppose ‘une tradition’, elle dégaine son flingue », explique tout de go son amie et grande reporter au Monde Annick Cojean, dans son introduction à leur entretien intitulé Une farouche liberté1. Après s’être affranchie de la famille juive, la jeune femme emprunte la voie de la liberté en laissant Dieu derrière elle. C’est ainsi qu’à dix-huit ans elle se retrouve seule à Paris, où elle étudie la philosophie et le droit à la Sorbonne.
Jamais refus que le sexe nous assigne un destin n’aura été plus absolu que le sien. À dix ans, la fillette faisait la grève de la faim dans sa Tunisie natale, s’élevant contre le caractère injuste du traitement différencié des garçons et des filles dans la famille. « C’est pas juste », trois mots courroucés qui reviendront souvent dans sa bouche comme un rappel au combat. Les parents affolés ont cédé : elle n’aurait plus à servir ses frères ni à la table ni ailleurs ni jamais. « Et quand on lui oppose ‘une tradition’, elle dégaine son flingue », explique tout de go son amie et grande reporter au Monde Annick Cojean, dans son introduction à leur entretien intitulé Une farouche liberté1. Après s’être affranchie de la famille juive, la jeune femme emprunte la voie de la liberté en laissant Dieu derrière elle. C’est ainsi qu’à dix-huit ans elle se retrouve seule à Paris, où elle étudie la philosophie et le droit à la Sorbonne.
Les pères qui doutent de leur influence déterminante sur leur fille devraient tendre l’oreille à une anecdote aussi touchante que révélatrice. Un concours d’éloquence sur le thème de la peine de mort avait été ouvert aux stagiaires en droit à Tunis ; Gisèle Halimi était la toute première à s’y inscrire, aux côtés de cinq jeunes hommes. Quand le bâtonnier a dit : « Vous avez la parole », elle a regardé son père et a perçu son émotion. Elle se remémore : « Et puis, je me suis sentie m’envoler ». Elle sera lauréate à l’unanimité. Son père exultait.
L’enfance décide, écrivait « son doux ami » Sartre dans Les mots. Chez Gisèle Halimi, il se profile dès l’âge le plus tendre l’incarnation fulgurante de la protestation féministe, celle de la deuxième vague, entre les années 1968 et 1989. Sa force sauvage et mauvaise, comme elle la nomme, fera le reste. On ne s’étonnera guère de sa réponse quand Annick Cojean lui demande ce qu’elle attend des femmes du XXIe siècle : « J’attends qu’elles fassent la révolution ».
On ne compte plus les précédents qui ont jalonné son existence. Aucune Française avant elle n’avait plaidé un recours en grâce pour des condamnés à mort politiques. Elle est la seule avocate à signer le « Manifeste des 343 », ces femmes très connues ou inconnues qui confessent avoir avorté dans l’illégalité. Aux côtés de ses complices de CHOISIR, armées d’un slogan-choc, 100 femmes pour les femmes, elle briguera les suffrages aux élections législatives de 1978. Au terme d’une campagne sans le sou, audacieuse, drôle, qui en a surpris plusieurs, CHOISIR sera éliminé au premier tour, et aucune de ses candidates ne sera élue. Quelques années plus tard, Halimi se fera élire sous la bannière du Parti socialiste, et sortira de l’Hémicycle aussi désillusionnée de la politique politicienne que de François Mitterrand. Nommée ambassadrice de l’UNESCO, elle place beaucoup d’espoir dans la création d’une Europe des peuples. Autour d’une équipe soudée et joyeuse, avocates, enseignantes, sociologues et autres syndicalistes publieront la somme de leur recherche en 2008, La clause de l’Européenne la plus favorisée, désireuses d’« instaurer un droit européen unique – et meilleur – pour elles ».
« Un pur bonheur féministe », s’exclamera la fougueuse femme de droit.
Les féministes d’alors étaient souvent associées à des bas-bleus et considérées comme sèches et rêches. Or l’épicurienne avocate recherche la joie et goûte à tous les plaisirs. Des luttes et de la tendresse partagées avec son fidèle « compagnon de route, de combat et de vie », Claude Faux, elle se rappellera : « On s’est bien amusés ». L’écrivaine et militante féministe algérienne Wassyla Tamzali confie que Halimi lui a montré « jusqu’où aller trop loin ».
Et le Panthéon à la fin de vos jours
La juriste philosophe meurt à 93 ans. Au Père-Lachaise, là où se tiennent ses obsèques en août 2020, que d’absences. Celle du président de la République, celle du ministre de la Justice, celle des juges, celles des confrères masculins. Seules trois bâtonnières, et le bâtonnier de Paris que la fonction oblige, parmi les douze qui se sont succédé depuis 1998, viennent lui rendre hommage.
Plusieurs réclament l’entrée au Panthéon, sanctuaire du conservatisme, de l’infatigable défenderesse des droits et libertés, de la plus célèbre avocate de France. Si cet honneur lui était accordé, elle serait la cinquième femme à reposer auprès de 73 hommes. Le cas échéant, il serait difficile de parler d’abus.
Une farouche liberté brosse un portrait énergique, sans aspérités, mais là n’était pas le but de cette rencontre entre l’avocate, dont la justice a été la grande affaire de sa vie, et Annick Cojean. Son parcours n’est pas sans rappeler celui de la « guerrière Ninja », feue Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis, qui a joué de la dissension, et à l’instar de Halimi, l’a mise au service de l’égalité et de la justice sociale.
En somme, une vie pleine et entière, et un ouvrage à cette mesure, bien tassé, dégageant des odeurs corsées comme le premier café de la journée, produisant des effets bien dosés. Aérien et amusant, vibrant mais léger, à sa lecture on redresse la colonne vertébrale et en écho au retentissant « C’est pas juste ! », on s’entend répondre avec l’avocate « Il faut faire quelque chose ».
Elle nous laisse sur ces mots : « On ne naît pas féministe, on le devient ». La lire est un pur bonheur tout court.
1. Gisèle Halimi, avec Annick Cojean, Une farouche liberté, Grasset, Paris, 2020, 157 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
Car en mon for intérieur, je décidai que mes mots, cette arme absolue pour défendre, expliquer, convaincre, se prononceraient toujours dans la plus absolue des libertés. Et l’irrespect de toute institution.
p. 38
Surtout, que mon sexe ne nuise pas à ma cause ! […] C’est bien simple : au début de chaque plaidoirie, je savais qu’il me fallait compter dix minutes pour forcer l’attention des juges. Dix minutes de perdues, uniquement parce que j’étais une femme. […] J’enrageais. Mais je savais que je les aurais à l’usure.
p. 42
Le chantre de la torture, le grand ordonnateur des exactions et du retour de la barbarie en Algérie, était le général Massu. J’ai débarqué à son QG, un jour de l’automne 1957, en pleine bataille d’Alger. Sans rendez-vous. Dans un état de colère immense.
p. 57
Pour obtenir la justice que je voulais, il fallait donc parfois transgresser la loi, et même la déontologie, comme je l’avais pressenti avant ma prestation de serment.
p. 63
Une chose est sûre : l’Europe ne se fera pas sans les femmes. Mais de l’avenir des femmes peut naître celui de l’Europe.
p. 124











