Deux siècles se sont écoulés depuis la première traduction française de Frankenstein1. Rédigée en 1816 par une Mary Shelley à peine âgée de dix-neuf ans, l’œuvre relate la création, par le jeune savant suisse Victor Frankenstein, d’un être vivant à partir de fragments de cadavres. À en croire la romancière britannique Jeanette Winterson, ce canevas jugé invraisemblable et aberrant sous la révolution industrielle n’est peut-être plus aussi inconcevable à l’ère de l’intelligence artificielle.
Figure de proue de la littérature queer au Royaume-Uni, Jeanette Winterson a fait ses débuts en 1985 avec Les oranges ne sont pas les seuls fruits, récit semi-autobiographique récompensé la même année par le prix Whitbread du premier roman (aujourd’hui Costa Book Award), puis adapté en minisérie par la chaîne BBC Two en 1990. Une bonne partie de ses œuvres ont été traduites en français, notamment les romans La passion (1987), Le sexe des cerises (1989), Garder la flamme (2004) et La faille du temps (2015), l’essai Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? (2011) et le roman jeunesse L’horloge du temps (2006). Les écrits commémoratifs semblent plaire à l’auteure puisqu’elle publiait en 2012 The Daylight Gate (« La porte de la lumière du jour »), une novella marquant les 400 ans des procès des sorcières de Pendle, et qu’elle participait en 2018 au projet « The Brontë Stones » en consacrant aux trois sœurs écrivaines un poème gravé sur pierre2. Dans Frankissstein3, finaliste du Booker 2019, c’est au monstre bicentenaire créé par Mary Shelley que Winterson s’intéresse. Certes, la romancière et professeure de création littéraire à l’Université de Manchester est loin d’être la première à se réapproprier le grand classique de Mary Shelley publié en 18184. La « culture Frankenstein », comme l’appelle Michel Faucheux5, comprend un vaste ensemble de romans, nouvelles, pièces de théâtre, films et bandes dessinées s’en inspirant ou y faisant référence. Le roman de Winterson se démarque toutefois en entremêlant la fiction historique à la fiction spéculative et en revisitant le classique de Mary Shelley sous l’angle de la transidentité et du transhumanisme.
1816 ou la genèse du monstre
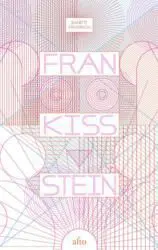 Les circonstances au cours desquelles l’idée de Frankenstein a pris forme fascinent presque autant la postérité que le roman lui-même. À cet égard, Winterson fait comme bon nombre d’auteurs avant elle – pensons à Federico Andahazi dans La villa des mystères (1998), à Emmanuel Carrère dans Bravoure (2008) ou à Judith Brouste dans Le cercle des tempêtes (2014) – et recrée l’une des plus célèbres anecdotes de l’histoire littéraire. Par une soirée orageuse de juin 1816, alors que le poète Percy Bysshe Shelley et sa femme Mary séjournent, en compagnie de Lord Byron, du docteur John William Polidori et de Claire Clairmont (la demi-sœur de Mary), dans les villas qu’ils ont louées en bordure du lac de Genève, la jeune femme est mise au défi par « le diable boiteux » (Byron) d’écrire une histoire de fantôme. Avec une grande habileté, Winterson retrace le fil des réflexions de Shelley tandis que la vision du créateur et de sa créature s’impose à elle. « Si un cadavre revient à la vie, se demande-t-elle, est-il en vie ? » Les contours de la réalité et de l’invention se brouilleront peu à peu et la jeune femme finira par rendre visite à Victor Frankenstein à la maison de fous de Bedlam.
Les circonstances au cours desquelles l’idée de Frankenstein a pris forme fascinent presque autant la postérité que le roman lui-même. À cet égard, Winterson fait comme bon nombre d’auteurs avant elle – pensons à Federico Andahazi dans La villa des mystères (1998), à Emmanuel Carrère dans Bravoure (2008) ou à Judith Brouste dans Le cercle des tempêtes (2014) – et recrée l’une des plus célèbres anecdotes de l’histoire littéraire. Par une soirée orageuse de juin 1816, alors que le poète Percy Bysshe Shelley et sa femme Mary séjournent, en compagnie de Lord Byron, du docteur John William Polidori et de Claire Clairmont (la demi-sœur de Mary), dans les villas qu’ils ont louées en bordure du lac de Genève, la jeune femme est mise au défi par « le diable boiteux » (Byron) d’écrire une histoire de fantôme. Avec une grande habileté, Winterson retrace le fil des réflexions de Shelley tandis que la vision du créateur et de sa créature s’impose à elle. « Si un cadavre revient à la vie, se demande-t-elle, est-il en vie ? » Les contours de la réalité et de l’invention se brouilleront peu à peu et la jeune femme finira par rendre visite à Victor Frankenstein à la maison de fous de Bedlam.
Immortalité inc.
Si la séquence historique de Frankissstein a déjà de quoi ravir le lecteur, c’est dans la portion spéculative (qui forme la trame dominante du roman) que Winterson déploie vraiment des trésors d’inventivité mais aussi d’ironie. Solidement documentée en matière d’intelligence artificielle – c’est le sujet de son plus récent ouvrage, paru à l’été 2021, l’essai 12 Bytes: How We Got Here. Where We Might Go Next (« 12 octets. Comment nous en sommes arrivés là. Où nous pourrions aller ensuite ») –, Winterson procède à un saisissant jeu de miroirs. Dans l’Angleterre de l’après-Brexit, un jeune chirurgien transgenre, Ry Shelley, fait la rencontre d’un mystérieux savant transhumaniste, Victor Stein, qui travaille secrètement à repousser les limites de l’existence humaine. Stein veut que la conscience puisse surmonter l’obstacle que représente l’enveloppe charnelle. Contrairement au Dr Frankenstein, il ne cherche pas à ranimer des corps inertes, mais à réactiver des cerveaux éteints. En plus de lui procurer des cargaisons de membres humains pour ses expériences, Ry fascine Stein et les deux personnages entament bientôt une liaison. Stein se défend pourtant d’être gai. Il perçoit le corps hybride de Ry comme une preuve d’évolution. Ce qui l’attire chez le médecin trans, c’est le fait que celui-ci a remodelé son être physique pour le rendre plus conforme à son identité profonde. Winterson fait également subir une métamorphose à Lord Byron, à Claire Clairmont et au DrPolidori. Le premier apparaît sous les traits de Ron Lord, un être grossier et quelque peu clownesque, qui fabrique des robots sexuels afin d’égayer les hommes seuls. La seconde s’appelle toujours Claire, mais la romancière en fait une prédicatrice afro-américaine. Le dernier devient Polly D., une journaliste au Vanity Fair, qui tente d’écrire le portrait de l’insaisissable Victor Stein. Brillante et savoureuse dissection de notre époque, Frankissstein procure le même plaisir de lecture que les fictions spéculatives de Margaret Atwood.
1. Le roman de Mary Shelley parut chez le libraire-éditeur parisien Alexandre Corréard dans une traduction française de Jules Saladin en 1821. Coïncidence funeste ou simple ironie du sort ? Corréard était l’un des naufragés de La Méduse en 1816. Géricault l’a d’ailleurs représenté sur son célèbre tableau Le radeau de la Méduse.
2. Ce poème, reproduit sur le site com, se lit comme suit : « BRONTËSAURE / La trace fossile d’un miracle / Os par os / Mot pour mot / Trois femmes qui écrivent le passé dans le futur / Ligne par ligne / Écoute le Wildfell de ton cœur / Ne trahis pas ce que tu aimes / La terre s’ouvre comme un livre / Tu reviens donc vers moi ? / BRONTISSIMO » (nous traduisons).
3. Jeanette Winterson, Frankissstein, trad. de l’anglais par Céline Leroy, Alto, Québec, 2021, 336 p. ; 29,95 $.
4. Il existe deux versions de Frankenstein ou le Prométhée moderne: celle des deux premières éditions de l’œuvre en 1818 et en 1823, et celle, remaniée, de 1831, qui sera généralement adoptée par toutes les rééditions subséquentes.
5. Michel Faucheux, Frankenstein, une biographie, L’Archipel, Paris, 2015, ouvrage recensé dans le numéro 145 (hiver 2017) de Nuit blanche: https:/commentaire-lecture/frankenstein/.
EXTRAITS
J’ai cru que tu étais un homme.
Je le suis. Anatomiquement, je suis aussi une femme.
C’est comme ça que tu te sens ?
Oui. Cette dualité est plus proche de la vérité qui me correspond.
Je n’ai jamais rencontré de personne transgenre.
Comme la plupart des gens.
Il sourit. Est-ce que nous ne venons pas de parler du fait qu’à l’avenir, nous pourrons choisir notre corps ? Et en changer ? Considère-toi en avance sur l’avenir.
p. 115
Le monstre une fois fabriqué ne peut être détruit.
p. 209
Posez-vous la question, Ron : qu’est-ce que la mort ?
Arrêtez vos bêtises avec moi, Ryan. Un mort est un mort.
Il y a un problème, Ron, et la solution à ce problème n’est pas réconfortante. D’un point de vue médical et légal, la mort survient suite à une défaillance cardiaque. Votre cœur s’arrête. Vous rendez un dernier soupir. Mais votre cerveau, lui, fonctionnera encore pendant environ cinq minutes. Ou dix, ou quinze dans les cas extrêmes. Le cerveau meurt parce qu’il est privé d’oxygène. Il s’agit de tissus vivants comme le reste du corps. Il est donc possible que notre cerveau sache que nous sommes morts avant de mourir à son tour.
p. 215











