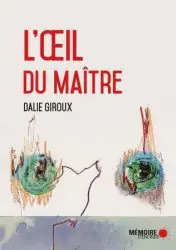Comme système visant à dégager des profits de l’exploitation de ressources naturelles d’un territoire annexé, le colonialisme implique trois acteurs principaux : le colonisateur, le colon et le colonisé. Soumises à l’interprétation, les conditions historiques qui ont façonné le Québec contemporain ont cependant eu tendance à brouiller les frontières entre les termes de cette triade.
Dans deux essais mordants qui font la chasse aux bons sentiments de l’histoire nationale, Alain Deneault et Dalie jettent un regard renouvelé sur cette sempiternelle question du legs colonial et sur les apories des discours indépendantiste et anticolonialiste au Québec.
Le Canada, le Québec : une bande de colons
Auteur phare de Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, Albert Memmi lui-même a eu maille à partir avec le cas québécois. Le fait tient, d’après Alain Deneault, à ce que la dialectique colonisé-colonisateur de l’intellectuel tunisien évacuait de l’analyse, par ailleurs essentiellement psychologique, la figure du colon.
Memmi ressentait ainsi un certain malaise à reconnaître aux Canadiens français le statut de colonisé entériné par tant d’intellectuels des années 1960, d’André d’Allemagne à Andrée Ferretti, de Pierre Vallières à Hubert Aquin, pour ne nommer qu’eux. Or, d’arguer Deneault en revisitant la pensée du chantre de la décolonisation, les Canadiens français, puis les Québécois, ne seraient ni colonisateurs ni colonisés. Ils correspondraient bien davantage selon lui au portrait du colon.
Contrairement au colonisé autochtone, explique l’auteur prolifique de La médiocratie et de Politiques de l’extrême centre, le colon ne se fait pas voler son monde lors de la Conquête de 1760. Il est plutôt frustré de ne pouvoir établir le sien. Cela dit, il voit le territoire auquel il s’accrochait passer sous la férule d’un nouveau pouvoir militaire, politique et économique, et il s’en ressent.
À la différence du colonisateur, le colon occupe une position hiérarchique subalterne. Il fait partie, dans les faits, des tâcherons affectés à l’exécution des basses œuvres coloniales, comme le dit le philosophe. Il représente les « petites mains » de la colonisation, ses « chevilles ouvrières », le travailleur de terrain sur qui repose la spoliation du colonisé et la vile besogne dont il retire très peu d’avantages.
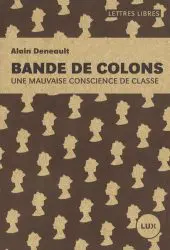 Quant au colonisateur, dans la typologie de Deneault, il se définit structurellement par son usage personnel du conflit d’intérêts. James McGill, John Molson, Robert Hamilton, Isaac Buchanan, par exemple, ont profité de leurs entrées dans le monde politique pour mettre en place des conditions qui leur étaient économiquement favorables. Un chapitre entier de Bande de colons1 est d’ailleurs consacré à la famille Irving, cinquième fortune canadienne, à la tête d’un conglomérat, d’une « colonie dans la colonie » qui tire les ficelles d’à peu près tout ce qui se trame dans les secteurs forestier, pétrolier, médiatique et agroalimentaire dans l’Est canadien.
Quant au colonisateur, dans la typologie de Deneault, il se définit structurellement par son usage personnel du conflit d’intérêts. James McGill, John Molson, Robert Hamilton, Isaac Buchanan, par exemple, ont profité de leurs entrées dans le monde politique pour mettre en place des conditions qui leur étaient économiquement favorables. Un chapitre entier de Bande de colons1 est d’ailleurs consacré à la famille Irving, cinquième fortune canadienne, à la tête d’un conglomérat, d’une « colonie dans la colonie » qui tire les ficelles d’à peu près tout ce qui se trame dans les secteurs forestier, pétrolier, médiatique et agroalimentaire dans l’Est canadien.
Cette confusion nourrie à l’égard de la fausse conscience de classe du colon, qui simultanément se pense en colonisé à la place du colonisé et se rêve en calife à la place du calife, est selon Deneault le fruit d’illusions entretenues par la machine coloniale, afin de maintenir les principaux intéressés dans un consentement tranquille à leur situation réelle : « [I]l vaut mieux accepter de nous tordre l’esprit de façon à nous dire semblables à l’image que renvoie de nous-mêmes le miroir déformant de la propagande à la canadienne, plutôt que de le casser pour nous admettre tels que nous apparaissons dans une image plus crue de nous-mêmes […] ». Certains esprits en mal d’emphase ou de grandeur nationale ont parlé du colon en termes de « bâtisseur ». Cinglant, Deneault parle de cette image plus crue qui apparaît, une fois brisé le miroir aux illusions, comme de l’« idiot utile de la colonisation ».
Maîtres chez qui ?
Ni colonisé ni colonisateur, le Québécois, comme le Canadien, s’avère donc selon toute vraisemblance, dans une écrasante proportion, un descendant du colon. Dalie Giroux, une autre essayiste qui philosophe à coups de marteau, et pour le plus grand délice du lecteur, abonde sensiblement dans le même sens : « Les Québécois ne sont donc pas, par leur population d’extraction française, des colonisateurs qui ont été colonisés », tranche-t-elle également. « Plutôt, ce sont des asservis temporaires puis des colons déchus, des travailleurs avec leurs dépendants, un peuple par défaut et jugé par tous bâtard qui s’est hissé au statut de colonisateur moderne, cela par le travail acharné et ambigu d’une petite élite entrepreneuriale au XIXᵉ siècle, d’une élite cléricale drapée de l’aura française au début du XXᵉ et d’une élite bureaucratique et culturelle à partir des années 1960. »
Dalie Giroux retient justement dans sa série de six essais, rassemblés sous L’œil du maître2, ce moment charnière des années 1960 où l’élite culturelle et bureaucratique du Québec adopte le discours victimaire du petit colonisé, culturellement et économiquement aliéné. Dans « Psychopolitique du colonisé québécois » et « Le dossier du nationalisme boucanier », emboîtant le pas aux trop rares Charles Gagnon, Rémi Savard et Jean Morisset, la professeure de théorie politique à l’Université d’Ottawa dénonce les visées trompeuses de cet aveu d’impuissance collective qui relève, d’une part – Deneault l’a établi avec force –, d’une usurpation de la mémoire historique, et peine, d’autre part, à masquer le désir d’une prise de pouvoir politico-économique prétendument confisqué par la Conquête.
Symptomatiquement, l’impérissable « Maîtres chez nous » a été le cri de ralliement sous lequel l’entrée des Canadiens français dans la modernité est passée à l’histoire. Aussi rassembleur et séduisant soit-il, ce cri, note toujours fort justement Giroux, dans le contexte de décolonisation dans lequel il s’inscrit, ne résonne pas sans soulever plusieurs problèmes notables. La question se pose en effet de savoir à la maîtrise de qui ou de quoi les Québécois visent-ils désormais, et à quel territoire ce « chez-nous » fait-il référence.
« La ‘maîtrise’ du ‘chez-nous’ », poursuit l’essayiste, a trouvé le chemin de son expression massive dans ce qui a constitué cette nouvelle ‘conquête du Nord’ qui commence avec la Révolution tranquille. Elle correspond bien sûr à la mise en place des infrastructures du réseau hydroélectrique québécois, clé de voûte de cette entreprise ». Or le Nord, de l’Eeyou Istchee au Nitassinan, fait encore remarquer Giroux, est alors un espace habité, un territoire où se reproduisent soudainement des dynamiques néocoloniales en tous points semblables à celles paradoxalement décriées par les exégètes locaux de Memmi, Fanon ou Césaire.
« Comment peut-on prétendre s’émanciper, se décoloniser, s’inscrire dans le grand mouvement de libération des peuples », ajoute fort pertinemment l’essayiste, le doigt dans le mou du bobo, « alors même que cette émancipation implique la reconduction des rapports de domination historiques et des racismes qui les irriguent ? » Il n’y a évidemment pas de réponses à cette question, sinon de très mauvaises, nous disent, volontiers piquants, Alain Deneault et Dalie Giroux dans Bande de colons et L’œil du maître.
Il leur a bien fallu pour cela cabosser quelques idoles, pour mieux faire entendre l’éclat dissonant de leur mécontentement dans l’assommant concert du nationalisme. Et s’il faut réellement parler d’indépendance, il semble que celle-ci passe, pour Giroux du moins, par une réelle intention de « décoloniser la décolonisation » : « La tâche décoloniale locale, au cœur de l’imaginaire colonial du Québec, serait donc de rassembler les moyens symboliques et matériels pour déserter la domus de Champlain, sortir de la maison du maître, cesser de dire que nous sommes ‘hydro-québécois’, détraquer la machine de capture impériale – qui que nous soyons, ici, maintenant ». Il y a là, à même ce contre-projet, quelque chose comme une proposition invitante.
1. Alain Deneault, Bande de colons. Une mauvaise conscience de classe, Lux, Montréal, 2020, 210 p. ; 21,95 $.
2. Dalie Giroux, L’œil du maître. Figures de l’imaginaire colonial québécois, Mémoire d’encrier, Montréal, 2020, 191 p. ; 21,95 $.
EXTRAITS
Colonisateur – colon – colonisé… Introduire ce trio, c’est reconnaître en fonction de quels rapports sociaux et géopolitiques s’est façonné ce que nous essayons tous les jours d’appeler « Canada » avec un semblant pathétique de consistance.
Bande de colons, p. 12.
Ainsi, au titre d’un patriotisme économique qui a fait même la fierté de la communauté de langue française, on a vu depuis quelques décennies se déployer dans le Nord québécois ainsi que dans les pays de l’hémisphère Sud des sociétés de génie industriel, d’exploitation minière, de transport aérien comme ferroviaire et d’hydroélectricité, sur un mode impérialiste qui n’a rien à envier à celui que le Québec a subi historiquement.
Bande de colons, p. 73-74.
La question politique québécoise pour le 21e siècle ne sera pas celle de trouver le chemin à emprunter pour enfin « véritablement » devenir maître chez soi, ce qui signifierait de compléter la colonisation européenne des Amériques en « notre » nom, mais de réfléchir et d’agir en fonction de l’objectif impérieux d’abolir, en mode grande alliance, toutes les relations de servitude qui font la forme coloniale franco-britannique de dépossession dont nous héritons, de manière différenciée, qui que nous soyons.
L’œil du maître, p. 39.
Les bâtisseurs sont aussi, dans la rhétorique du gouvernement actuel au Québec, « nos aînés », ceux qui ont « bâti le Québec ». Ce sont, si l’on veut, les ouvriers du domaine, les hommes à louer et leurs familles, les mercenaires du capital colonial en terre du Nord – ceux qui ont installé les entreprises là où, aux yeux du maître, il n’y avait « rien », rien que des charognards et des forêts trop denses, selon la version Samuel de Champlain […].
L’œil du maître, p. 162.